La réponse est indiscutablement OUI :
À l’évidence, cette époque n’a pas été avare en inventions, en événements lourds de conséquences et en personnages marquants par leur génie ou, hélas, par leur nocivité ; mais, indiscutablement, sur la plus haute marche du hit-parade des faits essentiels qui l’ont illustré figure…
l’arrivée du train dans l’univers de nos ancêtres.

Pourquoi le train est-il apparu ?
Évidemment parce qu’il était devenu indispensable !
L’essor du réseau routier avait été la formidable solution du 18e siècle ; mais elle avait atteint ses limites car la population avait augmenté de 40% pendant cette période et par conséquent les besoins en transport des marchandises et des personnes avaient explosé.
Et, bien sûr, il était évidemment impossible de refaire deux fois le fameux coup de la main d’œuvre rendue gratuite par la corvée royale.
Pour répondre à ce nouveau défi, il n’y avait que deux options possibles : multiplier le nombre d’aller-retours des véhicules et/ou augmenter fortement le poids des charges transportées à chaque voyage.
Cette deuxième alternative était évidemment la plus prometteuse tant du point de vue du coût que de celui des délais de livraison.
Mais alourdir la charge génère un très sérieux problème…
Car cela induit une très forte augmentation de la pression exercée par les roues sur le sol,
- d’où l’augmentation sévère des frottements,
- d’où la très forte majoration de l’inertie du véhicule,
- d’où la nécessité d’accroitre considérablement la force motrice.
D’autant que transporter des charges plus lourdes impose de renforcer le véhicule, ce qui le rend forcément plus lourd … ce qui majore encore les frottements…
D’autant que l’augmentation de pression sur le sol induit des déformations de la route, donc la dégradation du support qui devient encore moins roulant…
Augmenter drastiquement la charge transportée par voyage apparaissait donc être une impasse technologique et pourtant la solution à ce problème épineux fut trouvée !
Étonnamment, la solution préexistait au problème à résoudre et c’est au fond des galeries des mines qu’on l’a dénichée ; elle y était pratiquée depuis des décennies en France, en Angleterre et en Allemagne pour transporter les minerais qui en étaient extraits : cette solution, c’était… … le rail [1] !
La petite histoire du rail dans les mines
1- Longtemps le transport du minerai le long des galeries s’est effectué par le simple portage de sacs effectué par la main d’œuvre la moins qualifiée, c’est-à-dire les femmes (sacs jusqu’à 30 kg) et les enfants (jusqu’à 20 kg).
2- La constante augmentation des quantités de minerai extraites et l’insuffisance de main d’œuvre imposèrent l’usage d’un wagonnet monté sur des roues en bois et tiré à la bricole par des femmes et poussé par des enfants :

3- Suite aux passages répétés des roues au même endroit, le sol se creusait d’ornières et le chemin devenait difficilement praticable ; on y remédia en installant des planches de bois sous les roues :
4- Puis le chemin de halage fut aménagé ; pour assurer la stabilité du wagonnet et maintenir le parallélisme des planches, celles-ci furent fixées sur des traverses ; mais, entre les traverses, cela entrainait une trop grande flexibilité des planches et donc leur fragilité ; ce qui imposa de les rigidifier en augmentant leur épaisseur : les planches furent remplacées par deux barres en bois servant à la fois de support et de guide aux roues des bennes : le « rail » était inventé !
5- Les roues en bois furent ensuite cerclées de fer à l’instar des chariots pour renforcer leur solidité et limiter leur usure.
Le contact fer sur bois dur diminuait notablement les frottements et permis d’accroitre la charge des wagonnets jusqu’à 450 kg de minerai poussés par un seul homme (le rouleur).

6- Une ultime et substantielle diminution des frottements fut obtenue en remplaçant le rail en bois par le rail en fer à partir de 1820 : avec le roulement fer sur fer, le déplacement des charges par le rail nécessitait 6 fois moins d’énergie que pour tirer le même véhicule avec des roues cerclées de fer sur une route.

7- Au fil des siècles, les dimensions des galeries de mine s’étaient hypertrophiées au point de permettre la traction par des chevaux d’un train de douze wagonnets.

8- Du fait de son excellence, le tiercé gagnant rail en fer / roue cerclée de fer / hippotraction s’exporta hors des galeries pour gagner d’abord le carreau de la mine, puis le chemin pour rejoindre les ports fluviaux où les péniches assuraient le transport des minerais et du charbon. L’exposition aux intempéries imposa de stabiliser et de drainer le chemin ; ce problème fut résolu par le montage des traverses sur un ballast.

Les grandes étapes du train en France
Ensuite tout va très vite :
Avancée du réseau ferroviaire français :
Évolution de l’implantation des réseaux ferroviaires :
La confrontation de ces trois cartes est éloquente ; la progression du nombre des lignes est hallucinante et pourtant elle est bien en deçà de la réalité de l’évolution du transport ferroviaire car elle est muette sur le nombre de convois quotidiens par ligne.
L’exode rural :
Le 19e siècle, c’est aussi la révolution industrielle ; et la révolution industrielle, c’est la concentration du travail dans des lieux circonscrits ; ce qui imposait de répondre à trois critères :
• le déplacement de la main d’œuvre nécessaire,
• le transport des matières premières,
• puis celui des produits transformés.
Alors le support essentiel de la révolution industrielle fut évidemment le réseau ferroviaire…
La conséquence inéluctable de la révolution industrielle fut l’exode rural et le train y contribua considérablement par trois mécanismes :
1- Une première opportunité s’offrait aux plus miséreux : être l’indispensable main
œuvre pour la construction des voies, des gares et bâtiments annexes ; ils suivirent donc les lignes en construction et s’éparpillèrent tout au long des trajets, loin, de plus en plus loin…
2- La seconde résulte de l’activité ferroviaire elle-même : cette création ex nihilo et en extension quasi exponentielle a généré des métiers nouveaux non-agricoles qui constituaient des solutions inespérées pour ceux qui acceptaient de partir :
Effectif total des cheminots dans l’ensemble des compagnies ferroviaires :
3- un troisième scénario s’est répété dans chaque famille de crève-la-faim : pour
échapper à la misère, un membre de la famille se résout à quitter son village pour la ville où, révolution industrielle oblige, la demande de main d’œuvre était forte.
Puis, intégré dans son nouveau milieu, l’exilé sert d’exemple, de refuge temporaire et de pilote pour accueillir sa fratrie, ses cousins et ses amis tentés eux-aussi par l’aventure.
Le train, cet immense progrès pour les sociétés humaines, s’est donc construit aux dépends du milieu rural ; cette spoliation a été quantitative, mais aussi qualitative car les emplois les plus techniques ont été largement occupés par les artisans des villages obligés de se reconvertir parce que les objets et les outils qu’ils fabriquaient auparavant arrivaient désormais des manufactures par … le train ; il ne leur restait que la ressource d’aller exercer leurs talents au sein des compagnies ferroviaires.
Toutefois il faut noter que le lien social entre les exilés et leur famille restée au pays a été solidement maintenu grâce au train : le courrier postal, lui aussi, a été totalement métamorphosé en devenant service postal ferroviaire en 1845 ; le timbre-poste date de 1849 et le facteur assurait une distribution quotidienne du courrier dans le moindre village de France…
Exode rural et généalogie
Nos ancêtres vivaient solidement enracinés dans leur village dont ils ne s’éloignaient qu’à de rares occasions ; au 18e siècle, la création du réseau routier avait ouvert leur horizon jusqu’au canton grâce à la corvée royale ; au 19e siècle, le train a fait exploser leur univers tous azimuts par cet exode rural qui est bien visible dans bon nombre de nos arbres généalogiques : on peut même dire que nous descendons de nos aïeux, mais eux, ils descendaient du train !
Ainsi en est-il de mon arbre généalogique personnel qui en est un exemple caricatural :
Catastrophe ferroviaire…
Hélas, comme il n’était que trop prévisible, l’idée délétère de faire du train le moyen de déplacement des troupes, des armes et des munitions ne pouvait pas ne pas germer dans l’esprit des militaires …
La guerre de sécession américaine (1861-1864) inaugura l’usage du train comme auxiliaire militaire, mais son usage concomitant par les deux camps n’accorda aucun avantage significatif à l’un des belligérants.
L’emploi du train se révéla donc être une modification substantielle de l’art de faire la guerre, mais sans avoir vraiment une réelle influence sur son issue ; toutefois il est essentiel de préciser « sous réserve qu’il soit pratiqué par les deux adversaires » , parce que son sous-emploi par l’un d’eux donnerait évidemment un avantage majeur à l’autre…
Mais il y a eu la stupide guerre de 1870 et son anomalie sidérante…
Le 19 Juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse …
Nous ne nous attarderons pas sur le motif consternant du casus belli, ni sur le déroulement affligeant des opérations ; par contre, nous devons relever une incohérence sidérante :
C’est la France qui a déclaré la guerre, mais aucun de ses soldats n’a franchi le Rhin !!!
Eh oui, c’est là un fait ahurissant, mais flagrant : toutes les opérations militaires de cette guerre se sont déroulées en deçà de la frontière, sur le seul territoire français !
Du coup, nous sommes là devant un scénario tout à fait incongru : certes l’Histoire n’est pas avare de guerres déclarées par une nation beaucoup trop optimiste sur ses chances de victoire et qui se sont pourtant terminées par la défaite de la présomptueuse belliciste, voire même par sa véritable déconfiture ; mais l’extravagance d’un agresseur laminé en seulement 45 jours (mobilisation comprise !), sans avoir mis le pied chez l’ennemi, voilà qui défie l’imagination !
€n seulement douze jours, la Prusse mobilisa ses troupes sur la petite centaine de kilomètres de la frontière franco-prussienne : 450 000 soldats (sic), totalement opérationnels venus de toutes ses régions, renforcés par 80 000 soldats des armées de la Bavière, du duché de Bade et du Wurtemberg, pourtant tout juste ralliés. Et avec eux, bien sûr, les indispensables artillerie et intendance qui vont de pair…
Il s’agit là d’une fantastique prouesse technique qui n’a été rendue possible que par l’utilisation rationnelle et systématisée du réseau ferroviaire dans la stratégie prussienne.
Quant à l’Armée française, ses brillants stratèges n’avaient manifestement pas intégré les potentialités du train dans leur boite à outils puisque dans ce même délai de douze jours, ils n’avaient amené sur place que 240 000 combattants !!!
On connaît la suite …
Le train ou plutôt son mésusage par l’armée française est donc à l’origine de notre mémorable déculottée de 1870 !!!
Du train à l’apocalypse : un rocambolesque engrenage …

Et l’histoire ne s’arrêta pas là car la conséquence majeure de cette défaite ne fut pas (comme nos livres d’histoire le claironne à qui mieux mieux) la perte de l’Alsace-Lorraine, mais celle, concomitante, de la très stratégique frontière naturelle protectrice qu’était le Rhin [2].
Du coup, pendant 43 ans, nos dirigeants politiques et militaires n’eurent qu’une obsession : obtenir le restitutio ad integrum [3] et pour cela avec une obstination de psychopathes, ils préparèrent l’indispensable guerre pour y parvenir [4]… Et ce fut la boucherie de 1914-18 et ses 20 millions de morts…
Et l’histoire bégaya, les conditions de paix iniques imposées à l’Allemagne en 1919 [5] firent le lit du nazisme et Hittler rajouta 80 millions de victimes…
Et nous pourrions continuer : sans la Shoah, il n’y aurait pas eu l’État d’Israël et Gaza ne serait pas pilonnée quotidiennement aujourd’hui…
Alors, sans nous lancer dans un délire uchronique [6], force nous est de constater que le train, par son usage militaire non symétrique en 1870 a plongé par deux fois nos civilisations dans l’apocalypse, a dévié la trajectoire de l’humanité et fait explosé le cursus de nos généalogies. Quelle magistrale illustration de l’effet papillon [7] !
L’invention du train est le phénomène majeur du 19e siècle …
Le train a libéré les humains des 3 contraintes fondamentales de leurs déplacements Lors de leurs déplacements que sont le temps (= la durée), l’espace (= la distance) et le volume (la charge).
Pendant des millénaires, l’homme n’avait trouvé que deux expédients astucieux, mais fort modestes : le recours au cheval et au bœuf, puis l’adjonction du chariot grâce à la géniale invention (fort ancienne) de la roue.
Le réseau routier, réalisation majeure du 18e siècle, avait amélioré sérieusement les performances antérieures, mais ses potentialités et son expansion restaient limitées.
Le train a permis la vitesse, pulvérisant à la fois les contraintes durée et distance …
Le train a permis d’accroitre l’amplitude des volumes et des charges transportés dans des proportions stupéfiantes : « un wagon peut transporter jusqu’à 155 tonnes de marchandises, chaque essieu supportant une charge maximum de 44 tonnes. La charge totale du train est comprise entre 30 000 et 50 000 tonnes » .
Cette pulvérisation des 3 contraintes temps, espace et volume sera par la suite considérablement amplifiée par l’adjonction de la tentaculaire et invasive automobile, puis celle de l’avion…
Mais ceci est une autre histoire…
Hélas, hélas, si le train a fait progresser nos sociétés humaines de manière stupéfiante, son mésusage militaire les a aussi plongées par deux fois dans l’apocalypse et leurs conséquences perdurent encore.
Addendum
Il manque un chapitre à mon histoire et il se résume en une simple interrogation : pourquoi le train est-il apparu si tard dans l’histoire de l’humanité ?
• La question est légitime car dès les années 1700, des wagons avec roues en bois renforcées étaient utilisés dans les mines anglaises et dès le milieu du 18e siècle, les premiers rails entièrement métalliques étaient posés en Angleterre.
• Certes la machine à vapeur – dont le rôle a été prépondérant dans l’épopée ferroviaire – n’en était encore qu’à ses balbutiements (le fardier de Cugnot date de 1770 – le premier brevet de locomotive à vapeur par James Watt date de 1784) ; mais l’épopée du train, dans sa version traction hippomobile aurait donc pu commencer 3/4 de siècle plus tôt.
• Hélas, ce ne fut pas le cas et on peut le regretter car l’intermède hippomobile (qui ne dura que 4 ans (1827-1830) aurait alors été considérablement plus long, ce qui aurait permis de lisser dans le temps les perturbations majeures induites par la révolution ferroviaire et les auraient rendues plus « digestes » pour la société.
Puisqu’on ne sait pas pourquoi le train est apparu si tard, on peut aussi fantasmer sur ce qui se serait passé s’il était apparu encore bien plus tard : alors la grande invention et le grand progrès du 19e siècle aurait été le vélo…
À moindre échelle, lui aussi aurait révolutionné les transports des personnes (du moins sur les courtes et moyennes distances) et sous ses versions dérivées (tricycle et traction de remorque) assuré le transport des charges modestes de la vie courante …
Mais nous ne saurons jamais ce qu’aurait été une civilisation centrée sur la bicyclette ; pourtant ce qui est sûr, c’est qu’aucune armée au monde n’a gagné la moindre bataille en mobilisant ses soldats sur des vélos …
Le vélo est une invention qui n’a causé
aucun dommage collatéral …












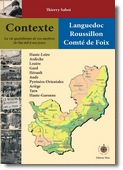


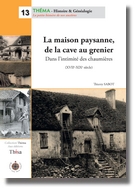


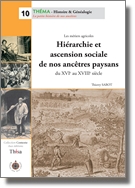


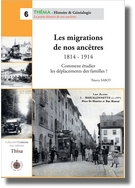
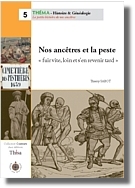


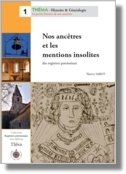


 Railleries
Railleries



