
Sa calèche passa sous l’arc de triomphe et le maire, Antoine Faye, avec son adjoint Vignol, lui offrirent du vin dans un tassou en argent, cadeau de la commune de Beaumont. Celui-ci laissera une somme de 500 francs pour les pauvres. Il y eut de nombreuses relations imprimées de ce voyage impérial (Cormier, Dousse, etc.). Je conserve le récit de cet événement, fait par mon arrière grand mère Bonnette Bardin, épouse de Jean-Baptiste Pageix, alors qu’elle était à l’école des sœurs de Gerzat.
Un peu d’humour en guise de conclusion... Du bandier au garde champêtre
Au Moyen Âge et au XVIe siècle [1], pour les assister dans leurs fonctions, les élus étaient entourés d’agents recrutés en principe pour une année. Ces officiers étaient rémunérés. Celui qui semble avoir tenu un rôle d’homme à tout faire - au moins à leurs yeux - était le bandier ou gastier. Au moment des vendanges, sont rôle essentiel était de garder les vignes afin d’ en éloigner les prédateurs de toutes plumes et ...de tous poils...
Ainsi, les élus de 1502, Jacques Mège dit Lhonard et Anthoine de Mezes dit Grasset mirent et choisirent un bandier ou gastier dont la tâche essentielle consistait à surveiller les blés, vignes et arbres fruitiers contre les prédateurs de tous poils et de toutes plumes... Le choix se porta sur Johan Marsent (ou Marsant), dont les gages furent fixés pour l’année à 6 livres tournois.
Ce Bandier, qui peut être comparé au garde champêtre de nos villages, était l’homme à tout faire de la commune, qu’on désignait comme « le serviteur des élus » ; c’est peut-être pour cela que ceux-ci lui octroyaient des gratifications supplémentaires, comme ce fut le cas en 1502 où il reçut vingt sous de plus pour ses services de l’année, car il avait oeuvré « pour le bien commun et pour la cause des maulx que l’on fesoit pour la pardicion des blés, vignes et des fruictz ». Le bandier veillait aussi au bon déroulement des vendanges et, lorsque les élus estimaient qu’il convenait de renforcer la surveillance des pampres arrivées à maturité, ils allaient recruter d’autres bandiers dans les paroisses voisines. Ainsi, en 1527, alors que les vendanges « acommensarent par pans, le lundi 21 Octobre » les élus allèrent chercher les « bandiers de Chamalhere et les trouvarent dans le treulh et cuvaige du Chappitre ». Ils leurs demandèrent leurs tarifs, et il s’ensuivit un marchandage quelque peut sordide : 10 livres, 5 livres, puis 50 sous, et enfin 35, qu’il déclarèrent être leur dernier prix ! Finalement, les élus ne voulant pas leur donner plus de 30 sous, chacun se cantonna sur ses positions ! Rentrés bredouilles à Beaumont, les élus firent leur rapport aux habitants. Ceux-ci les dépêchèrent aussitôt « devers Romaignihat pour les avoir ». Heureusement pour les élus, les bandiers de Romagnat, qu’ils trouvèrent derrière Montrognon, se firent moins prier et acceptèrent d’être recrutés pour 20 sous seulement !...
Les registres des délibérations municipales tenues à l’époque de la Révolution, que j’ai entièrement transcrits, contiennent eux-aussi des passages assez cocasses à propos des gardes champêtres :
Le 7 mars 1790, le conseil général se réunit à la réquisition du procureur de la commune "qui a dit que plusieurs particuliers de ce lieu lui ont porté des plaintes sur le dommage causé par les troupeaux de moutons tant dans les vergers que dans les vignes, qu’il seroit en conséquence nésessaire qu’il fut interdit aux propriétaires de ne plus les y mener en quelque saison de l’année que ce soit même les bœufs et les vaches dans les vergers clos, et qu’il soit nommé un garde qui soit autorisé à prendre les dits bestiaux trouvés dans les dits vergers et vignes, auquel garde il soit payé un gage.
"Le procureur de la commune (Pierre Goughon, notaire) a aussi requis qu’il soit fait défense à tout particulier de ce lieu de laver dans le bac de la fontaine de la place aucun linge, choux, ni autres choses et d’autoriser un particulier à y veiller."
"Sur quoi le conseil général intimement convaincu de la vérité de l’exposé ci-dessus a unanimement nommé pour veiller à la conservation des héritages, et pour qu’aucun particulier n’y mène des moutons, brebis, chèvres et autres bêtes en aucune saison de l’année, la personne d’Antoine Georget huissier de l’endroit, y habitant, lequel sera tenu d’y veiller soigneusement, de saisir ou dresser procès-verbal des contraventions qui pourront être commises à cet égard."
"Et pour tenir lieu de salaire au dit Georget, il lui sera payé sur les revenus communaux de ce lieu la somme de huit livres par mois à compter du jour qu’ il entrera en fonction, indépendamment des amendes qui pourront être prononcées pour raison des prises de bestiaux qu’il fera et qui lui appartiendront."
"Il a été aussi d’une voix unanime décidé que le dit Georget sera suivi et accompagné dans ses tournées ordinaires par deux habitants chaque jour et à cet effet sera remis au dit Georget un tableau contenant les noms et le nombre des particuliers qui devront l’assister et qu’il sera tenu de prévenir la veille du jour que deux de chacun des dits particuliers devront garder."
Antoine Georget, convoqué dans l’instant, a prété serment, tout en réclamant les salaires qui lui sont dus car il assure ces fonctions depuis déjà six semaine.
Sur le deuxième point évoqué par le procureur, il a été arrêté "qu’aucun particulier ne pourra laver aucune espèce de linge ni herbage dans le bac de la fontaine de ce lieu et pour veiller tant à cela qu’à la propreté de l’eau du dit bac et de l’entour de la fontaine, le corps municipal a nommé la personne de Jean Vergnette voisin de la dite fontaine auquel il sera payé la somme de quinze livres annuellement qui sera également prise sur les deniers communs de ce lieu".
Jean Vergnette, également convoqué, "a déclaré qu’il veilleroit avec la plus grande attention à la propreté du dit bac et à ce qu’aucune femme fille ni autre personne n’y aille laver" !...
Ce "dispositif " un peu trop sophistiqué ne semble pas avoir persuré, car le 30 décembre 1792, le conseil général de la commune sous la présidence, du maire Étienne Pageix, se réunit à la requête du procureur Pierre Goughon qui rapporte qu’en l’absence du garde champêtre, "un grand nombre de particuliers mènent indifféremment dans les héritages des uns et des autres des brebis, chèvres et vaches dans les pré vergers et dans les vignes ; que les animaux y causent un dégât irréparable, en broutant l’écorce des jeunes arbres et en cassant les échalats, que d’ailleurs sous le prétexte de garder leurs brebis et chèvres, les enfants ou femmes chargés de ce soin enlèvent et volent le bois, rompent les échalats et font un tort très considérable. Ces abus encore tolérés deviendroient d’autant plus abusifs qu’il seroit difficile de les contenir et darrêtre leur progrès".
Le citoyen Truchaud, citoyen habitant de la ville de Clermont, se présentant pour remplir les fonctions de garde, "fonctions qu’i a rempli sans reproches", le conseil l’a nommé garde messier avec appointements annuel de 220 livres. De plus, "il sera logé dans une petite chambre à plein pied de la cour de la cy devant abbaye à droite en entrant". Le montant des amendes encourues fut ensuite fixé par un arrêté de police : 20 sous pour tout particulier qui aura fait paître ses animaux dans les pré vergers terres semées et vignes ; pour toute bête trouvée et saisie dans tout autre héritage que celui des propriétaires des bêtes, pour les vaches, 10 sous par tête, pour les chèvres 20 sous,et pour les brebis et moutons 5 sous aussi par tête et le double en cas de récidive, le tout indépendamment des dédommagements dûs aux propriétaires.
Ainsi, on pourrait penser que de nombreux Beaumontois, peut-être un peu trop enthousiasmés par les libertés nouvelles apportées par la Révolution, se crurent autorisés à commettre de tels actes d’incivisme...
Au XIXe siècle, la commune embaucha un garde champêtre [2]. La loi ne pesait pas toujours uniquement sur nos vignerons, si l’on en juge par cette situation assez cocasse où le garde-champêtre de Beaumont fut lui-même pris en défaut : c’était bien sûr pour une toute autre raison, bien expliquée dans le compte rendu de la séance du conseil municipal du 31 mars 1871, où il est indiqué qu’ « à la suite des vendanges (celles de 1870), le garde-champêtre a fait une quête de vin à son profit. Cette manœuvre constitue un abus immoral entravant la liberté de ses fonctions ».
Du coup, que fit-on pour prévenir de futurs abus ? On augmenta son traitement « qui passa de 450 à 550 francs, payables le 31 décembre de chaque année ! » On peut comprendre cette attitude clémente de la part du conseil municipal, car la faute était somme-toute assez vénielle et l’on remarquera que la date coïncidait à quelque chose près avec la fin de cette malheureuse guerre franco-prussienne...

On ne peut clore cette évocation du vignoble beaumontois, qui constitua durant des siècles la source de revenu principale de nos ancêtres vignerons, sans dire un mot du phylloxéra. Ce maudit parasite, en provenance des États-Unis, débarqua en France vers 1870 et ne fut bien présent en Auvergne qu’à partir de 1890. Pour le combattre, après arrachage des ceps atteints, il fallu les remplacer par des plans...américains, sur lesquels on greffa des cepages résistants.
On créa un comité départementale du Puy-de-Dôme d’Études de Vigilance contre le Phylloxéra qui organisa dans les communes viticoles des écoles de greffage, et un diplôme de greffeur était délivré après un examen.
Voici le diplôme de greffeur décerné le 3 avril 1892 à Alexandre Bouchet (le futur général de division aérienne...), cousin de mon grand père Pierre Pageix, par le « Comité départemental du Puy-de-Dôme d’Étude de Vigilance contre le Phylloxéra. Le Directeur de l’école est Bertrandon et le Maire Bayeron.

Mon grand oncle, Joseph Pageix, évoquait dans son ouvrage déjà cité la préparation des vendanges, qui commençait avec les bouviers de la montagne, qui venaient avec leurs attelages pour transporter la vendange. Chacun d’eux avait à Beaumont son vigneron attitré, son "maître" ou "chalonge", à qui il offrait chaque année ses services.
On appréciera au passage la verve et l’humour de Joseph Pageix, qui décrivait ainsi la rencontre entre l’un de ces voituriers et son employeur :
"Ils prolongeaient volontiers cette petite station chez chacun de leurs chalonges, car, tout le monde sait bien qu’autrefois le vin était de luxe à la montagne, la boisson habituelle étant le « petit lait ». Il ne leur déplaisait pas de venir ainsi de temps en temps se rougir un peu la conscience avec le contenu d’un pichet cerclé de cuivre, qui ne faisait que gravir et descendre les degrés de la cave en leur honneur. « Buva nin, nin büri beïo pas demô » (buvez-en, vous n’en boirez peut être pas demain), disait le chalonge en versant à ras bords."
"Eux, en riant, se laissait faire. Ils détournaient à demi la tête quand leur hôte saisissait le pichet, et tout à coup, - quand le verre était plein, - levant la main, ils faisaient mine de protester : « Tche tche tche ! Certas frère ! Rassas ! Veze be que voüli me fère fiurlà ; ène ô lô voutrô » (Certes, frère, assez ! Vous voyez que vous me faite soûler ; à la vôtre), disaient-ils d’un air résigné."
"Ils buvaient sec, tant et si bien que certains, le soir venu, songeant malgré tout à regagner leur village, mais voyant trente-six têtes à leur cheval, étaient incapables de trouver la bonne pour lui passer la bride, et s’obstinaient à présenter le mors aux barreaux du râtelier. Les bras levés, se pointant sur leurs sabots, balançant, soufflant, ils se fatiguaient vite à cette fausse manœuvre, et, de guerre lasse, se laissant doucement couler sur la paille de l’étable, ronflant bientôt à poings fermés, ils s’en remettaient à cette sagesse de la Providence pour la question de leur retour".
Plus loin, il évoque "la loue" : ainsi désignait-on l’embauche de la main d’œuvre nécessaire aux vendanges. Bien avant jour, les vignerons se rassemblaient sur la place du village où se pressaient déjà tous les bouviers venus de la montagne pour se louer :
"Dès trois heures du matin, l’Angélus, suivi de la sonnerie de la grosse cloche à toute volée, se chargeait de réveiller les dormeurs les plus endurcis en annonçant la « loue ». C’est à ce signal que se rassemblait sur la place de l’église une foule de montagnards venus de tous les coins du département, et même des départements voisins. Ils étaient partis, la veille ou l’avant-veille, à pied, par bandes joyeuses, vidant les hameaux, n’y laissant que le personnel indispensable aux soins du bétail."
"Leurs sabots ferraillant sur les cailloux du chemin, marquaient la cadence des chansons qui les entraînaient dans leur marche, leur faisant oublier la distance et la fatigue. Ils portaient dans le panier un léger bagage, tout juste de quoi se changer quand ils rentreraient trempés par la pluie. Et ce qui les attirait ainsi dans le pays vignoble, c’était moins l’appât des quelques pièces d’argent qu’ils serreraient au retour dans le « bas de laine » que la gourmandise du raisin, eux privés de fruits en toute saison."
"Beaucoup avaient, comme les bouviers, leurs maisons attitrées et retrouvaient dans un coin de la « fenière » leur lit de l’année précédente".
"Quelques maisons hospitalières ouvraient aux autres les portes de leurs granges. Mais un grand nombre – les hommes surtout – n’attendaient pas, pour se rendre sur la place, que sonnât l’Angelus. Ils étaient là, dans le noir de la nuit, serrés contre les murs à l’abri du vent, formant des petits groupes où se discutaient les prix qu’ils allaient demander, s’interrompant parfois pour « battre une semelle » endiablée afin de vaincre le froid qui les engourdissait. Quand la place commençait à se peupler et que paraissait un vigneron muni de sa lanterne, il était aussitôt entouré."
"S’adressant à la première personne qu’éclairait son rayon de lumière :
- « Combe voulez-vous gagna drolô ? » (Combien voulez-vous gagner, drole ?) ;
- « Trentô sus, mas seis pas tôt surlô, seins quatre do mémô violadze...Che voulez nous pregne tutas nus arrandzôrins beyo be ! » (Trente sous, mais je ne suis pas tout seul, nous sommes quatre du même village...Si vous voulez nous prendre tous, nous nous arrangerons bien) ;
"Lui, tout en discutant, promenait sans façon son falot sous le nez de chacune afin de juger de leur mine. - « Seis be in pô veillô vous ! »(Vous ne seriez pas un peu vieille, vous ?) ;
- « Et vous, seis pas vieux grand chimple ! » (Et vous, n’êtes vous pas un vieux grand simple ?) ;
- « Sabez vindegna au moins ? » (Savez-vous vendanger au moins ?) ;
- « Pregna me ô l’issayô, zu virez be. » (Prenez-moi à l’essai, vous verrez bien) ;
- « Té ! Tï nin nô dzunô que me convèndiôt be ! (Tiens, voilà une jeune qui me conviendrait bien) ;
- « Eh be, pregna me, ma seis môridadô, faut pregne me n’homme pô pourta l’hotô. » (Eh bien, prenez-moi, je suis mariée, il faut prendre mon homme pour porter la hotte) ;
- « Certas ! - disait l’homme en question, - ma que me bouéyez bure de bounnô tizanô, foré be voutrô bezugnô. » (Certes, pourvu que vous donniez à boire du bon vin, je ferai bien votre besogne) ;
- « Seis be in pau n’haut pô vuida lus pôners ! » (Vous êtes bien un peu grand pour vider les paniers) ;
- « Ma, me côtôrai be in peti pau. » (Mais je me baisserai bien un petit peu) ;
- « Eh ne ! Bouèye viengt’ô chinq sus mi las fennas et trentô sus mi le bôrtère, che cou vous convait segua me. » (Et je donne vingt-cinq sous aux femmes et trente aux bertiers, si cela vous convient suivez-moi) ;
- « Eh be ! Coui n’ôffouère tssobôdô. » (Eh bien, c’est une affaire finie) ;
"Et ils suivaient la lanterne jusqu’à la maison où, par précaution, ouvrant la porte du cuvage, le maître leur disait, sans paraître le moins du monde y attacher de l’importance, - mais il avait son idée - : « Eh be ! In pitant lô soupô posa tï voutri pôners » (En attendant la soupe, posez là vos paniers) , et il donnait un tour de clef. Car, il lui était arrivé plus d’une fois de se trouver bien attrapé pour avoir négligé cette simple mesure de prudence. Certains, en effet, que n’embarassaient pas précisément les scrupules, à qui l’on n’avait pas eu l’idée de faire laisser là leur bagage, se dépêchaient de retourner sur la place offrir à nouveau leurs services, et n’hésitaient pas à planter là leur premier maître pour suivre celui qui leur offrait seulement deux sous de plus."
"Et allez donc les reconnaître, quand vous avez à peine vu le bout de leur nez sous le rayon fumeux d’une lanterne !"
Quelques vieilles photos :
- Les vignes des Rivaux.
On aperçoit une tonne et un cheval près de sa charrette. On distingue les Côtes de Clermont en arrière-plan sur la photo de gauche (Coll.Jacques Pageix).

- Les vignes des Liondards vue panoramique.

Le chemin de fer serpente entre les vignes qui couvrent toute la pente jusqu’aux portes de Clermont. Au premier plan : les vignes de mon arrière grand père Jean-Baptiste Pageix-Bardin.
J’ai fait ce montage avec les tirages sur papier réalisés par contact direct des négatifs (plaques de verre) ; photos prises un peu avant 1900 par mon grand oncle Joseph Pageix. On reconnaît d’ouest en est : Montaudou, le Puy de Dôme, les Côtes de Clermont. On aperçoit un groupe d’ouvriers maçons construisant une première maison... qui en annonce bien d’autres.



Après les vendanges, on distillait le marc de raisin.
Voici l’alambic qui se trouvait dans la descente du cuvage de la Place d’Armes, chez mon arrière grand père Jean-Baptiste Pageix-Bardin. Il aurait été réquisitionné pour l’utilisation du cuivre lors de la guerre de 1914-1918. La qualité de bouilleur de cru s’éteignit avec mon grand père.














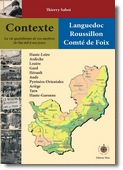


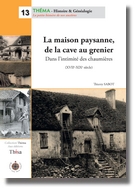


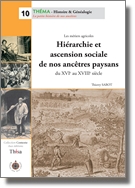


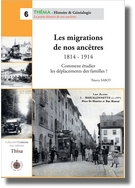
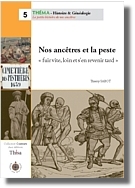


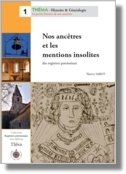


 La visite de Napoléon III à Beaumont (Auvergne) le 29 juin 1862
La visite de Napoléon III à Beaumont (Auvergne) le 29 juin 1862