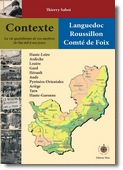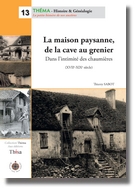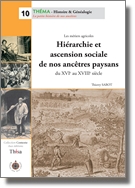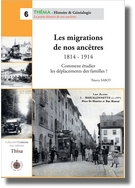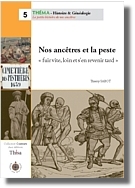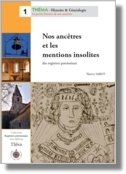En réalité pourtant, dans la plupart des cas, la liste gravée dans le marbre n’est pas parfaite, ce qui choque vivement ceux qui en prennent conscience, qu’il s’agisse des élus souvent amenés à rénover ce monument sacré, des journalistes couvrant les commémorations, ou des habitants dont beaucoup portent encore l’un des noms de la liste.
Comment expliquer ce désordre ?
Dès 1914, la qualité de « Mort pour la France » fut attribuée aux civils et aux soldats victimes de la Première Guerre mondiale ; ainsi, tout au long du conflit, le ministère de la Guerre tint à jour un fichier de tous les soldats honorés de cette mention qui répondait à des critères précis : seules les personnes décédées entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, morts sur le champ de bataille ou à cause de dommages directement imputables au conflit, seraient susceptibles de la recevoir. Mais ce n’est qu’en 1929 qu’une liste officielle sera dûment établie, on verra plus loin comment.
La population, elle, meurtrie mais soulagée, voulait tourner la page. Trop d’espoirs avaient été déçus, trop d’angoisses et de souffrances avaient paralysé les existences, un fol appétit de vivre plus légèrement s’empara de la population. C’est dans ce contexte que se produisit la marée de construction des monuments aux morts de la guerre. Coup double : d’abord honorer la mémoire des héros qui avaient permis la victoire, mais aussi clore par un acte commémoratif officiel la présence obsédante de cette « der des der » qu’on ne voulait plus voir.
En l’an mil, le moine Raoul Glaber aimait à voir la France se couvrir d’un « blanc manteau d’églises » dans les villages. En 1920-1925 c’est d’un blanc tissu de monuments aux morts que se sont couverts les mêmes villages. Chacune des 36 000 communes a voulu le sien, mais en plus nombre d’institutions, religieuses ou laïques, ont aussi voulu le leur, ne serait-ce qu’une plaque dans l’église ou le temple, dans les grandes écoles, dans les entreprises.
Plusieurs erreurs ont alors pu se produire, tant la précipitation fut grande. Il n’est pas rare que des fautes d’orthographes entachent un patronyme un peu compliqué, ou qu’il y ait des erreurs de prénom. On s’en est sans doute aperçu dès l’érection du monument, mais il était souvent trop difficile de rectifier, graveurs débordés, budgets insuffisants… Une autre source d’errements sur ces monuments est le mode d’établissement de la liste. Qui y mettre ? Les natifs de la commune, ou les habitants en 1914 ? Des réponses différentes à ce choix ont entraîné des disparités considérables dans les listes : certains noms figurent sur plusieurs monuments (lieu de naissance et lieu d’habitation), d’autre ne figurent sur aucun, nés quelque part mais partis depuis longtemps, et résidents de trop fraiche date ailleurs.
Par ailleurs, parallèlement à cette frénésie mémorielle bien visible, l’administration militaire tissait patiemment sa toile dans le silence des bureaux.
Par la loi du 25 octobre 1919, « relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande guerre », l’État avait lancé le projet d’un Grand Livre d’Or comprenant les noms de tous les héros, qui serait déposé au Panthéon. Le ministère des Pensions, nouvellement créé, fut chargé d’établir, à partir du fichier existant, la liste des Morts pour la France de chaque commune ; il l’adressa en 1929 aux maires pour la contrôler et l’amender. Des correspondances témoignent souvent de ces échanges entre les deux parties.
En 1935, la présentation matérielle du futur Livre d’or fut fixée : 120 volumes devaient être imprimés en plusieurs exemplaires, dont un serait déposé au Panthéon. Les contraintes budgétaires, puis le début de la Seconde Guerre mondiale, mirent fin au projet, ne laissant subsister que la documentation préparatoire.
Les Archives nationales conservent ainsi pour chaque commune française la liste des soldats Morts pour la France, classée par ordre alphabétique des départements puis des localités. Ces listes nominatives communales permettent de connaître les nom et prénom de chaque personne, ainsi que la date et le lieu de son décès. En principe les personnes mentionnées sont celles qui sont nées ou résidaient dans la commune au moment de la mobilisation, mais un flou a longtemps subsisté sur cette question ; c’est ce qui explique, pour une part, les divergences entre les listes communales officielles (livre d’or) des Morts pour la France et les noms portés sur les monuments aux morts. Les listes définitives ont fait l’objet d’une numérisation dont les images sont consultables en ligne.
Voilà pourquoi la nécrologie de la grande guerre n’est pas une science exacte, elle ne peut se faire qu’en confrontant les archives disponibles :
- état-civil des communes,
- registres matricules des conscrits à l’âge de 20 ans,
- monuments aux morts,
- livres d’or,
- fichier Mémoire des Hommes,
- Grand mémorial.
A titre d’exemple des discordances observables, voici ce qu’il en est de trois communes du Lot très proches les unes des autres :
- Mauroux : 22 noms sur le monument aux morts, 18 sur le livre d’or, les noms du livre d’or figurent tous sur le monument aux morts, il y a donc 4 noms en plus sur le monument aux morts.
- Sérignac : 18 noms sur le monument aux morts, 16 sur le livre d’or, 14 d’entre eux figurent sur les deux, donc 4 noms en plus sur le monument aux morts et 2 en plus sur le livre d’or.
- Lacapelle-Cabanac : 3 noms sur le monument aux morts, 4 sur le livre d’or, 2 d’entre eux figurent sur les deux, donc 1 nom en plus sur le monument aux morts et 2 en plus sur le livre d’or.