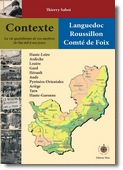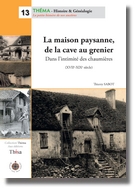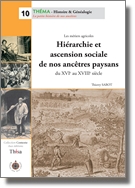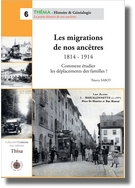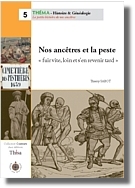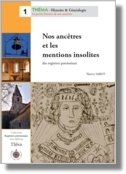L’Italie, qui obtint son unité nationale en 1859-1860, fut un retardataire dans la course aux colonies d’Afrique que disputaient les puissances européennes. Les ambitions italiennes étaient à l’origine de s’installer dans une région le long de la côte de la mer Rouge auparavant occupée par les Turcs Ottomans et revendiquée par la suite par l’Égypte et l’Éthiopie. Entre 1869 et 1880, la Rubattino Navigation Company fit l’acquisition auprès du sultan local de parcelles de terre le long de la côte de la mer Rouge. Ces acquisitions furent transférées à l’État italien en 1882, et en 1885 des troupes italiennes débarquèrent à Massawa, à Assab et à d’autres endroits le long des côtes. L’Éthiopie reconnut le contrôle italien sur la région située le long de la mer Rouge en mai 1889. En 1890, l’Italie déclare officiellement l’Érythrée comme sa colonie, lui donnant son nom actuel dérivé de Mare Erythraeum, le nom romain de la Mer Rouge pendant l’Antiquité. Le 1er mars 1896, lors de la Bataille d’Adoua, l’armée éthiopienne de l’empereur Menelik II vainquit les forces italiennes surpassées en nombre, arrêtant ainsi la tentative de l’Italie d’étendre sa colonie de la Mer Rouge en envahissant des parties de l’Éthiopie (d’après Wikipedia).
9 mars :
Je monte sur la passerelle à 8 h. Nous avons dépassé Périm et même le Banc Scylla sur lequel la Diana a omis de sonder. Et pourtant on ne voit rien. Nous avons une brise très fraiche de l’arrière, nous roulons et l’horizon est très embrumé. Un cargo à tribord sort de la Mer Rouge.
Aperçu le phare de Ras Fatima, puis l’île basse. Mis en route sur Assab. Peu avant d’arriver au mouillage, j’aperçois droit devant une bande jaunâtre très suspecte. Je fais diminuer de vitesse et contourner cette tâche. Mouillé, non sans peine à 800 mètres de l’extrémité de la jetée.
Beau paysage de fond de montagnes. Au premier plan la petite ville, très blanche. Dans le sud les salines avec leur grand bâtiment.
Visite officielle du Résident, un gosse qui porte deux galons. Ascaris qui arment son embarcation, très bien tenus mais vêtus comme des singes. Costume de coton blanc à pantalons bouffants, haut tarbouche barré en diagonale d’un ruban de bateau, gland vert.
La mer est assez grosse au mouillage. L’après-midi je reste à bord. L’Amiral descend à terre et revient trempé. Il a été frappé par la discipline des indigènes qui font tous le salut fasciste.
10 Mars :

Nous avons intercepté cette nuit deux télégrammes entre Assab et un bâtiment de guerre. A 8 heures, on m’annonce que deux sous-marins arrivent au mouillage : le Luigi Settembrini et le Ruggiero Settimo (900 t).
L’Amiral envoie un officier de corvée pour inviter les deux commandants à déjeuner. Un capitaine de frégate chef de groupe et commandant du sous-marin et un capitaine de corvette. Le capitaine de corvette me demande des tuyaux sur le Prométhée et s’étonne que le même tuyautage d‘huile puisse servir à lancer les moteurs et à ouvrir les purges. Il verrait plutôt la solution inverse : quand on ouvre les purges, stopper le Diesel. Je lui dis alors qu’on ne pourrait plus plonger avec les Diesels. Il me répond que cela n’a pas d’importance et qu’on n’a qu’à plonger toujours sur électrique. Il ne comprend d’ailleurs pas pourquoi on veut rentrer dans l’eau en vitesse, alors qu’un tel procédé fait des remous (Oui, mais le sous-marin n’est plus où est le remous quand on s’en aperçoit). Lui déclare que le meilleur moyen est de plonger statiquement. D’ailleurs ils ne naviguent jamais les prises d’eau ouvertes.
Il a plongé à 105 m et me déclare qu’ils n’ont eu que 3 x/x de déformation. Je n’en crois rien.
Leurs équipages de la Mer Rouge n’ont plus de vin, mais du thé et de la citronnade. Ils sont 58 à bord de l’un des deux. Le chef d’escadrille a à son bord deux ingénieurs du GM. L’autre un ingénieur du GM et un mécanicien. 2 officiers de quart seulement.
GM : Génie Maritime. Les ingénieurs du GM travaillent sur des projets innovants, notamment dans la conception et la fabrication de sous-marins.
Ils ont quitté Tarente le 11 février, sont allés à Tobruk, Port Saïd, Massawa et viennent d’Aden. Ils remontent à Massawa, Port Saïd, Alexandrie et Tarente. Au total deux mois de croisière.
Dîner le soir chez le Résident avec les commandants et deux officiers des sous-marins italiens. La mer est un peu tombée et nous arrivons à terre à peu près sec. Bungalow très vaste, maigrement installé. Dîner détestable et juste en quantité. A dix heures nous partons. La brise a fraichi à nouveau et la mer déferle. Nous sommes douchés des pieds à la tête.
11 Mars :
Appareillage à 5h30 pour arriver de bonne heure à Massawa demain. Cela permettra peut-être à l’Amiral de liquider les visites officielles avant le déjeuner et d’aller se promener l’après- midi. Nous pourrions ainsi monter à Asmara après-demain 13, en revenir le 14 à midi et appareiller le lendemain matin pour Souakim où nous ne pouvons arriver que de jour.
A l’appareillage, presque calme. Aussitôt sorti d’Assab, la mousson souffle à nouveau très fraiche. Nous roulons assez violemment. Vers 11 heures, la mer tombe, bien que la brise reste aussi fraiche. Le bateau ne bouge presque plus. Vers 16 heures, la mer se creuse ; nous n’avons pas de grand roulis, mais les lames bien formées mangent un peu notre arrière. L’horizon est très brumeux. Nous sommes poussés par le vent et nous gagnons près de deux milles par heure. La lune est pleine et est levée avant que le soleil ne soit couché. Il disparait dans le nuage de sable qui monte de la terre.
Nous cherchons le feu de Shab Shakhs par le travers duquel nous devons tourner. Il n’apparait qu’à 7 milles, alors que sa portée est de 17 ; sa lumière est rougeâtre, noyée dans la poussière.
 Après le dîner, je regarde la lune à la jumelle. Elle est d’une clarté remarquable. Sur sa gauche, assez haut, Mars rougeâtre. Du même côté, à la hauteur de la terre, Jupiter. Je n’ai jamais observé aussi bien les détails de la lune que ce soir. J’ai l’impression de la voir nettement sphérique. Sur son côté droit un xxx d’où rayonnent des traits lumineux, comme du nœud d’une orange partent les rides. A la partie inférieure un cratère très net avec une frange brillante.
Après le dîner, je regarde la lune à la jumelle. Elle est d’une clarté remarquable. Sur sa gauche, assez haut, Mars rougeâtre. Du même côté, à la hauteur de la terre, Jupiter. Je n’ai jamais observé aussi bien les détails de la lune que ce soir. J’ai l’impression de la voir nettement sphérique. Sur son côté droit un xxx d’où rayonnent des traits lumineux, comme du nœud d’une orange partent les rides. A la partie inférieure un cratère très net avec une frange brillante.
Je vais me coucher de bonne heure, parce qu’on doit me réveiller vers 2 heures pour le passage du détroit de Shumma, entrée du chenal sud de Massawa.
12 Mars :
Monté sur la passerelle à 4 heures. On n’a aperçu le feu de Shumma qu’à 7 milles ; aussi est-il par le travers quand j’arrive en haut. La mer est absolument plate. La lune est toujours là, mais Jupiter et Mars ont passé à sa droite.
Le jour vient ; la lune se noie dans la brume. Il fait un temps superbe. Nous mettons le cap sur Massawa et sommes amarrés dans le port à 8 heures. Il fait très chaud dans le port dès le matin. Visites officielles.
Le soir, vers cinq heures, le gouverneur nous mène faire un pèlerinage au monument aux morts de Dogali à une vingtaine de kilomètres de la ville. C’est là qu’en 1887, 500 Italiens envoyés en renfort furent surpris par 10000 abyssins disent les Italiens. Ils se réfugièrent sur un piton, pensant que cette position était très forte et que de là le bruit de la fusillade serait entendu de Massawa. Le Khamsin ayant soufflé, on n’entendit rien. Ils furent pressés, obligés de charger et à peu près tous furent tués. Route des criques entre des collines, sur une bonne piste traversant plusieurs oueds desséchés très vastes. Cette piste longe la voie ferrée. Tous les indigènes saluent à la fasciste.
13 Mars :
Levé à 5 heures pour prendre à 6 h 30 le train d’Asmara. Amiral, Badens, Marliave, Dinechin, Bourreuf, Mousset.
Il fait très humide et le soleil est caché derrière des nuages sales et très bas. J’aimerai mieux ne pas avoir de pluie là-haut, parce que nous partons en blanc. Au sortir de la ville, sur les récifs qui bordent une partie du village indigène, de nombreux habitant sont installés à faire leurs petits besoins. De loin je croyais qu’ils faisaient leur prière. Un factionnaire monte la garde ; pour cela aussi sans doute, le fascio a réglementé les rites.
Après avoir dépassé Dogali, où nous sommes venus hier, la voie ferrée entame la montagne. Contraste avec la voie désertique d’Addis. Ici des mamelons velus, de l’herbe et de la vraie, des petites fleurs des champs. On se croirait en Corse ou en Auvergne. Beaucoup d’espaces cultivés en maïs.
Aux gares, tout est calme. Cela a perdu tout le pittoresque évidemment, mais on ne peut pas reprocher aux Italiens d’avoir supprimé la mendicité automatique. A la gare de Maialto, une négresse accroupie devant sa marmite qui bout sur trois pierres. De ses longs bras, elle l’empoigne de temps à autre, verse un peu de liquide fumant dans une calebasse, bat quelque chose dedans et reverse le liquide dans la marmite.
On débouche dans une vaste plaine, qui de loin, du moins, n’a rien d’Africain. Beaucoup d’arbres, des cultures, mais très peu d’habitations. Aux branches des arbres à épines pendent des quantités de nids de bengalis qui gazouillent. On est assez étonné de lire DAMAS sur la gare. Le train monte rapidement, sans secousses. Les ravins deviennent de plus en plus profonds.
Comme nous avons un train officiel, qui ne s’arrête que pour prendre de l’eau ou changer de locomotive, nous ne savons pas à quelle heure nous arriverons. Comme nous devons débarquer en tenue blanche de visite officielle, dès dix heures nous allons tous successivement nous changer dans la partie vide du wagon. La tenue en blanc pour les visites officielles a des avantages puisqu’elle ne nécessite ni le chapeau ni les aiguillettes, mais le blanc est une tenue bien fragile pour le train.
A 11 h 45, nous débarquons à Asmara. Sur le quai, le commandant des troupes et quelques officiers. L’Amiral, Badens et moi, sommes conduits au Palais du Gouverneur où nous devons être logés.
 Présentations officielles. Les officiers qui nous ont accompagnés prennent congé et vont à l’hôtel ; nous déjeunons avec le gouverneur et quelques invités. Déjeuner court.
Présentations officielles. Les officiers qui nous ont accompagnés prennent congé et vont à l’hôtel ; nous déjeunons avec le gouverneur et quelques invités. Déjeuner court.
Nous sommes logés à l’annexe, où j’ai un appartement (un salon, une chambre et une salle de bain).
Le Palais lui-même, qui est de style italien et n’a rien de colonial, ce qui n’est pas nécessaire dans ce pays où il ne fait jamais chaud, est confortablement installé et fait honte à Djibouti. Il est précédé d’un magnifique jardin de fleurs – parterres de géraniums et d’arums ; tout cela soigné et arrosé copieusement.
Après le déjeuner, conversations sous la véranda. Le ciel est parfaitement pur. Il souffle une brise fraiche délicieuse qui nous fait augurer que notre tenue de toile est un peu juste pour le soir. C’est que nous sommes à 2400 m, aussi haut qu’à Addis.
J’entreprends un jeune fonctionnaire colonial qui a déjeuné et qui parle très bien le français. Sa femme, qui est là, est une parisienne.
Il me dit que la colonie est bien pauvre et que la verdure superbe que nous avons vu sur la route n’est qu’une fertilité apparente et éphémère. Dans un mois, il n’en restera plus rien. Toutefois d’autres régions seraient susceptibles d’être cultivées, mais il faudrait pour cela beaucoup d’argent. Le budget de 40 millions de la colonie n’est pas suffisant pour en distraire une partie à des subventions. L’immigration italienne est assez intense, mais ils doivent les contrôler pour ne pas risquer de voir venir des gens qui feraient une tentative malheureuse et qui deviendraient rapidement des miséreux. Il en existe pas mal déjà de cette sorte.
Au point de vue forces, les Italiens ont l’air décidé à ne plus employer que de l’aviation. Ils attendent d’ailleurs 18 appareils. C’est à peu près l’unique moyen de transport qu’utilise désormais le Gouverneur. Avec des avions et des terrains qu’ils ont déjà complétés par leur réseau de postes de TSF, ils n’ont rien à craindre.
Ils recrutent des indigènes qui sont instruits ici, y restent ensuite ou sont envoyés en Tripolitaine. Engagement minimum de deux ans. Recrutement de 5 à 10000 par an. Il y a actuellement 5 bataillons en Érythrée, 1 escadron de cavalerie et 3 batteries d’artillerie. Il y a 6 bataillons érythréens en Tripolitaine. Compagnies à 200 hommes avec cadres italiens et indigènes ; camps analogues à ceux de nos Sénégalais. Ce sont de très bonnes troupes et certains de ces soldats sont au service depuis la campagne de Lybie.
Il me raconte au sujet des communications entre Massawa et Assab par terre, qui sont encore à peu près impossibles, l’histoire d’une bande d’Anglais qui s’est enlisée avec des voitures entre les deux ports. On a dû envoyer une caravane les dégager… Pour faire des photos intéressantes ces Anglais avaient eu l’idée de traîner au bout d’une longue corde derrière leur dernière voiture un chameau crevé. Les bêtes, attirées par l’odeur sur cette trace, se mettaient à la poursuite de la charogne. Les Anglais sont ainsi arrivés à avoir 20 lions sur la même photo. On voit, parait- il, de ces lions dans des attitudes grotesques tendant la patte vers le chameau qui leur échappe, parce lorsqu’ils ont approché la voiture a mis en vitesse en avant.
Sieste.
A 17 h, réception au Cercle Militaire. On se croirait dans une ville de garnison européenne. Des quantités d’officiers, des fonctionnaires fascistes. Des femmes assez bien habillées, certaines élégantes. Quand on songe qu’à Djibouti, il n’y a qu’un seul officier et seulement depuis 15 jours. Il y abus des deux côtés.
Les Italiens sont tout de même très voisins de nous, sinon comme mentalité, du moins comme civilisation et nous pouvons constater qu’ils s’occupent vivement de tout ce qui se passe en France, alors que chez nous c’est l’indifférence, néfaste d’ailleurs à leur égard. Ils lisent les journaux, discutent de nos livres.
D’après des renseignements, les Italiens auraient en Érythrée 100 officiers employés à l’instruction des indigènes.
Dîner officiel au Gouvernorat. Le Gouverneur est très sympathique. 50 ans, en porte moins, distingué. Toast très cordial. Mais pourquoi sommes-nous les seuls dans nos rapports avec les Italiens à parler des légers différends qui nous séparent ?
Réception après le dîner, ma foi assez brillante.
Piqué par des moustiques, que je zigouille. Barbouillé d’Insectol. Ce n’est pas la peine de monter à 2400 m.
14 Mars :
Départ en voiture à 9h 15 pour faire un tour en ville. L’air est d’une pureté délicieuse, assez frais, et le soleil tape dur.
Passé à l’Église catholique. Clocher en campanile vénitien. Pierre et briques. C’est tout neuf et ne représente pas plus d’intérêt que tous les monuments récents de notre culte qu’on rencontre un peu partout.
Église copte, beaucoup plus intéressante, même dans sa misère. Sur le côté d’un terrain vague en pente qui porte cette église, un bâti de bois sous lequel on a suspendu quatre grosses pierres allongées par les deux bouts. Ce sont les cloches.
A gauche de l’église, le long d’un mur qui en fait partie, un paquet de gens alignés qui écoutent l’Évangile que leur lit un prêtre. Son bréviaire est posé sur le dossier d’une chaise recouverte d’une étoffe. Il est abrité par un parapluie rouge à bords blancs.
On monte à l’église par quatre marches étroites et élevées. Les fidèles, parait-il, les montent en se frappant le front sur chacune d’elles.
Intérieur très pauvre et sale divisé en trois parties ; à partir de la porte, celle des fidèles, puis celle du clergé et enfin le saint des saints fermé par un rideau, sorte d’iconostase. De chaque côté de la porte du saint des saints des peintures barbares d’influence byzantine. A droite de la porte un porte-cierge ignoble couvert de vieux bouts de bougie. Sur le sol des nattes et des tapis en loques… Dans cette pouillerie on reconnait tout de même la disposition en trois loges des temples antiques.
Visite du camp du bataillon indigène. Très propre, jardins, tennis, cercle. Les soldats logent avec leurs familles dans des toukouls. On dirait un camp de Sénégalais.
Puis, à l’École, 900 élèves indigènes - bonne tenue – des sœurs blanches italiennes. Tout le monde fait évidemment le salut fasciste et les gosses récitent l’hymne d’amour à l’Italie et au Roi.
L’hôpital, particulièrement bien tenu avec pavillons de spécialités, salles d’opération, maternité. La station de radio commandée par un L.V. Les Italiens y forment du personnel indigène.
Enfin le Fascio, dont la salle de réception, très vaste est complètement décorée de peintures abyssines tordantes et très décoratives. L’arrivée de la reine de Saba chez Salomon. La chasse au lion, la chasse à l’éléphant. Un grand combat. Des lunules avec des oiseaux et des animaux stylisés très agréables.
Dans la cave du Fascio un « Keller », un peu trop genre allemand.
Toutes ces visites donnent vraiment l’impression que ces gens travaillent avec cœur pour le prestige et la grandeur de leur pays. On sent qu’ils sont pauvres, et qu’ils ont, malgré leur confiance, une angoisse du lendemain, n’étant pas certains d’avoir les moyens matériels de poursuivre.
Lorsque nous rentrons avant le déjeuner, le gouverneur vient accueillir l’Amiral et nous invite à voir les écuries. Très bien tenues ; deux chevaux offerts par l’Imam Yaya à son prédécesseur. Ils sont marqués sur la fesse du mot « Allah ».
Déjeuner avec le Gouverneur et son secrétaire.
A 14 h départ. Le train descend très vite. Superbes ravins qu’on surplombe. Il fait chaud dans le train.
Quand on compare cette ligne à celle d’Addis, on peut dire que celle d’Asmara est un tour de force de construction en montagne, analogue à ceux qu’on est obligé de réaliser dans les Alpes, par exemple, mais elle ne donne pas l’impression d’un travail presqu’au-dessus des forces humaines comme celui qui a été fourni sur la route d’Addis. Ici, pas d’attaques xxx à craindre puisque toute la ligne est sur le territoire de la colonie et que les Italiens ont pu pacifier le trajet puis l’occuper réellement pendant le travail ; ici, non plus, pas de régions désolées, brûlées et terribles comme en Abyssinie.
Retour à Massawa à 18 h 30. Le ciel est chargé de pluie et il fait très humide. Le Gouverneur est descendu par le même train.
Dîner officiel sur la Diana – Gouverneur, Commandant des Troupes, Administrateur de Massawa, secrétaire du fascio… Toast cordial. Le Gouverneur est particulièrement aimable et gai.
Après le dîner, café sur le spardeck. Il pleut et nous sommes dans un bain d’humidité.
15 Mars :
A 9 h le Gouverneur vient rendre officiellement la visite de l’Amiral. Nous appareillons aussitôt après. Le Gouverneur appareille avec les deux sous-marins. Ils ont embarqué des chefs indigènes.
Un cargo voisin a mouillé ses deux ancres sur notre chaine tribord. Nous en avons pour des heures avant de pouvoir sortir. Le Vimy attend dehors. L’imbécile de pilote a mouillé aussi l’un des sous-marins sur les ancres du cargo. C’est une salade telle que, malgré toutes les embarcations du port, nous ne sommes dégagés qu’à 2 h 30 de l’après-midi. Nous n’arriverons certainement pas avant après-demain matin à Souakim.
Le ciel est bleu, la mer est belle. Légère brise du nord.
Brumasse le soir, mer calme, un peu de houle du nord. Nous naviguons à 4 milles de terre et les fonds sont à surveiller avec soin. La lune se lève à 10 h et va être bien utile.