A l’inverse, les domestiques, valets et servantes de ferme, souvent encore jeunes et célibataires, laissaient peu de traces dans les registres d’état-civil. Une fois par an, à date fixe, employeurs potentiels et candidats convergeaient vers le champ de foire. Un simple accord verbal, un simple "tope-là" ou une bonne poignée de main suffiraient à engager les deux parties pour les douze mois à venir. Avant l’aube, le domestique avait fait son paquetage, quitté la fermé qui venait de lui servir de cadre de vie depuis toute une année, et le lendemain il embaucherait dans une autre ferme, située le cas échéant dans une autre commune des environs, voire à l’autre bout du canton, avec d’autres compagnons de travail... Contrat purement verbal, il est généralement très difficile voire impossible d’en retrouver aujourd’hui les modalités. Tout au plus quand on aperçoit un domestique dans un acte d’état-civil, peut-on supposer qu’il ou elle avait été embauché(e) à la louerie la plus proche de l’exploitation de son employeur, en date et en lieu, et donc de sa commune de résidence du moment
Une fois n’est pas coutume, j’ai trouvé un acte de mariage (le 10/10/1826 à Juvigny-sur-Seulles) qui permet (indirectement) de savoir précisément quand, et donc où, le couple de domestiques en question a été recruté. Comme aucun des deux n’était natif ni domicilié dans la commune au jour de la noce, M. le maire a cru devoir préciser : « profession de domestique, demeurant depuis le vingt-deux juillet dernier en la commune de Vendes et auparavant en la commune de Juvigny ».
Autrement dit, tout s’explique par leur profession : ces deux domestiques ont changé de domicile, et donc d’employeur(s), le jour de la Sainte-Madeleine, jour de la louerie de Tilly-sur-Seulles, le chef-lieu de canton.
On notera qu’à l’époque, ladite louée de Tilly se faisait encore à date fixe, le 22 juillet de chaque année (jour de la sainte-Madeleine), en prémices de la foire de Tilly, vieille institution ressuscitée un demi-siècle plus tôt par M. de Fontette, nouveau seigneur du lieu (qu’il fit ériger en marquisat) et Intendant de la généralité de Caen. Or, bien évidemment, étant à date fixe, ledit jour pouvait tomber en semaine...
Quelques années plus tard, une âme bien pensante de la préfecture imagina qu’il serait préférable d’organiser la louerie uniquement le dimanche "le plus proche du 22 juillet". Du point de vue des employeurs qui, bien souvent, étaient aussi les élus locaux, on évitait ainsi de perdre une journée de travail...
Aux mêmes causes, les mêmes effets ! On étendit la même formulation à toutes les loueries du département. Mais cette égalité de traitement toute administrative avait oublié une contingence matérielle...
A Creully, à 10 ou 15 km de Tilly, la louerie de domestiques se déroulait jusque là le jour de la Saint-Clair, le 18 juillet, date la plus souvent retenue à travers toute la Normandie. Reprenant la susdite formulation, le même élan préfectoral avait donc décidé que la louerie de Creully se déroulerait dorénavant le dimanche "le plus proche du 18 juillet".
Aucun souci quand les foires de Tilly et de Creully se déroulaient à date fixe, et donc à quatre jours d’écart.
Hélas ! Cent fois hélas ! Le rédacteur avait "oublié" que "le dimanche le plus proche", ça veut dire avant ou après... et donc lorsque ce dimanche tomberait les 19, 20 ou 21 juillet, les deux loueries allaient se dérouler le même jour et se feraient concurrence...
Par une délibération du 13/08/1893 le conseil municipal de Creully sollicita donc une modification de l’arrêté pour que les deux loueries se déroulent dorénavant systématiquement à une semaine d’écart. Tilly fit-elle la même demande ? Malheureusement, impossible de le vérifier, les archives municipales ayant péri en 1944.
Plus de précisions sur : https://www.creully.net/2012/12/1857-creully-tilly-sur-seulles-une.html
L’exode rural du XIXe s. mit en péril cette institution. Les jeunes gens des deux sexes, partis en ville, n’étaient plus là pour se louer à l’année. L’offre se faisant de plus en plus rare, les plus compétents se louaient à prix d’or, se faisaient reconduire d’année en année et se faisaient embaucher avant la date de la foire. Pour les employeurs les moins fortunés, il fallait se contenter de ceux qui restaient...
Mais, si elles ont survécu en Normandie plus qu’ailleurs, la première guerre mondiale va porter le coup de grâce aux loueries de domestiques. En août 1909, la Revue Illustrée du Calvados publia un long reportage sur une des dernières loueries ayant eu lieu à Bayeux. Voir en ligne, sur le site des AD du Calvados
C’est dans ce cadre géographique (le nord du futur canton de Tilly-sur-Seulles) et sociétal (les relations entre maîtres et domestiques de ferme) que s’inscrit l’Hôtel Fortuné, une des Nouvelles Normandes de Gaston LAVALLEY. La bâtisse existe toujours, nettement visible de la N13 qui relie Paris à Cherbourg. L’auteur place l’action de son roman lors du voyage de Louis XVI à Cherbourg, le seul voyage de longue durée que le roi fit en province avant la fuite à Varennes. Il s’agissait pour l’heure d’aller assister aux travaux qui, à terme, allaient doter Cherbourg de la plus grande rade artificielle du monde, en l’occurrence l’immersion d’un des cônes de la Grande Digue. Nous nous situons donc à la mi-juin 1786. Si la Saint-Clair est évoquée, ce n’est pas forcément comme foire aux domestiques mais comme terme du contrat de la bonne, annuellement reconductible.











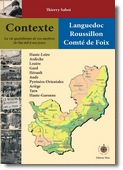


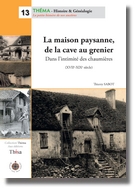


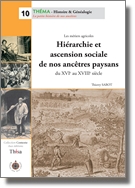


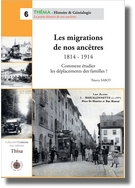
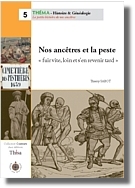


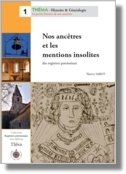


 Une institution d’antan : les loueries ou louées de domestiques
Une institution d’antan : les loueries ou louées de domestiques