Le contexte
Afin de mieux comprendre les textes qui suivent, il est nécessaire de donner quelques précisions sur le fonctionnement – complexe et variable aussi bien dans le temps que suivant les régions - de la société sous l’Ancien Régime.
La France à cette époque était partagée en provinces de deux [1] types : les pays d’état et les pays d’élection. Les premiers, disposaient d’un parlement régional (ou « état ») qui votait la contribution fiscale. Les états d’élection quant à eux étaient des circonscriptions financières soumises à la juridiction d’officiers royaux appelés élus (qui ne sont pas élus, mais ont acheté leur charge). Ces élus étaient sous la tutelle de l’intendant de la province.

L’Auvergne était un pays d’élection. L’intendant résidait à Riom. Chanteuges dépendait d’élus résidant à Brioude : les subdélégués.

Les élus répartissaient l’impôt entre les différentes paroisses ou mandements [2]. Ils éditaient les rôles, documents indiquant précisément la quote-part de chaque ménage. Localement donc étaient nommés des collecteurs chargés de collecter l’impôt. Ces collecteurs, sous l’autorité des représentants locaux du pouvoir royal, procureurs d’office en général, étaient nommés par les habitants de la paroisse au cours d’une assemblée des habitants convoquée par les autorités locales « dans la manière ordinaire à la sortie de la messe de dimanche ». Ces assemblées d’habitants rassemblaient en fait les chefs de famille les plus importants.
Ces collecteurs étaient choisis parmi les plus riches car ils devaient répondre sur leurs biens de la collecte de l’impôt. Nul ne pouvait refuser cette charge.
Les consuls ou syndics étaient nommés de la même façon : ils étaient censés représenter les habitants pour la gestion de la communauté. Il semble qu’ils pouvaient intervenir pour la répartition de la taille mais sans pouvoir rien décider eux-mêmes.
L’administration royale était représentée par un bailli chapeautant les autres titulaires d’un office : procureurs, greffiers, notaires, huissiers, lieutenants, sergents… À ce pouvoir royal se superposait le pouvoir seigneurial qui, quoique de plus en plus faible, tenait à ses privilèges. Et ceci sans oublier le rôle de l’Église chargée entre autres de gérer l’état civil.
A Chanteuges, le seigneur était l’abbé de la Chaise-Dieu, qui possédait le prieuré. Les habitants possédant un bien immobilier devaient lui payer une redevance sur ce bien (le cens [3], dont le montant était fixé une fois pour toutes), en plus de la taille (pour le roi) et la dîme (pour l’église). Et pour entretenir ses armées et financer ses guerres, Louis XIII avait rajouté la subsistance. Ces impôts rajoutés au fil du temps à la taille portaient le nom général de crues.
Le mandement de Chanteuges comprenait, outre la paroisse, qui correspond à l’actuelle commune, divers lieux situés dans la commune de Saint-Arcons : Bavat, Beaune [4], le Jarisson, Navat ou celle de Mazeyrat : Paysat.
L’administration fiscale, basée sur la paroisse, distinguait le bourg (Chanteuge bourg) comprenant la Vialle et le Peyroux et auquel étaient associés les terrains proches, et les villages (Chanteuge parroisse). À chaque village étaient associés des terrains dits « aux appartenances de ... ».
L’État civil était tenu par le curé dans le cadre de la paroisse.
Jusqu’en 1787, l’église paroissiale se trouvait à la Vialle, à l’emplacement actuel de l’ancienne ferme Coston. En mauvais état « comme elle a besoin de grandes réparations [le grand vicaire de Saint-Flour] les a prévenus qu’elle était dans le cas d’être interditte […] les consuls ont ajouté que leur église n’était pas assez vaste pour contenir les parroissiens, qu’elle est d’ailleurs trop humide et malseine parce qu’elle est trop creusée » [5], elle fut remplacée en 1787 par l’église du prieuré, abandonnée par les moines : « messieurs les religieux bénédictins de Chanteuges ont depuis plusieurs années quitté leur maison et église dudit Chanteuges ».

- La Vialle.
Fin du XVIII e siècle.
En 1792 l’église saint Saturnin et l’ancien cimetière, inutilisé depuis plus de 10 ans, sont vendus [6] à 18 habitants de la Vialle pour 300 livres, en même temps qu’est vendue l’ancienne cure située de l’autre coté du chemin, en face de l’église, « composée d’une petite cour, cuisine, cuvage, trois chambres, aisance et galetas, en mauvais état, donnant au levant et bize par la rue publique et par la maison de Pierre Vidal, de midi et nuit par le jardin curial estimée cent soixante et dix livres » à Claude Vaisson [7], vigneron, pour 1050 livres.
En 1794 les acquéreurs de l’église et de l’ancien cimetière les revendent [8] à Pierre Vidal [9], cultivateur pour 320 livres.
Un autre acteur important dans les actes qui suivent est la famille Péghaire. Comme il sera expliqué plus loin, on peut raisonnablement penser que les Péghaire, bourgeois et notables depuis plusieurs générations, habitaient la maison actuellement au 1 de la rue de l’église. La délimitation précise de leur maison est inconnue : sans doute à l’origine englobait-elle les bâtiments placés au sud [10] de la zone délimitée en rouge sur le plan [11] ci-dessus.

- La maison Péghaire aujourd’hui.
Dans la partie du bourg située en dessous du prieuré il est fait mention d’une place dite « du Taret » ou du « Caret » suffisamment grande pour qu’il y ait un arbre : une proposition est faite dans le plan qui suit pour son emplacement [12].

Il est aussi souvent question d’une famille de notables, les Duchamp. Une maison, fort ancienne à en voir l’apparence, et de belle allure, détruite dans la première moitié du XXe siècle appartenait à cette famille bourgeoise [13] : édifiée dans la parcelle 893 du plan napoléonien, elle apparaît dans une photo [14] de la fin du XIXe siècle.

- La maison Duchamp à la fin du XIXe siècle.
A suivre...











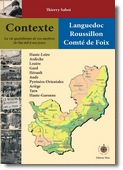


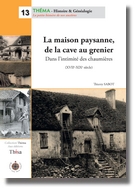


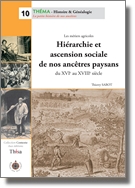


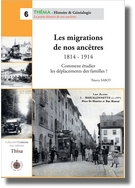
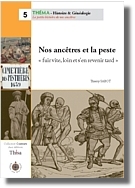


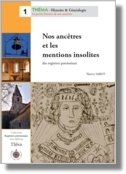


 Quelques évènements survenus à Chanteuges aux XVIIe & XVIIIe siècles
Quelques évènements survenus à Chanteuges aux XVIIe & XVIIIe siècles