La tante Joséphine, alias Jeanne HARDING, demi-mondaine et artiste lyrique
Joséphine est la troisième fille de François HARDIN et Jeanne HIRIGOYEN [1]. Elle nait à Bayonne le 20 septembre 1862.
C’est sous le nom de Jeanne HARDING qu’elle va s’illustrer.
La presse pipole n’est pas une invention récente. Les moindres faits et gestes de Jeanne HARDING au fil des années y sont relatés. Le Mondain lui consacre en 1894 un portrait [2], sans doute largement romancé, qui évoque ses débuts dans la carrière.
« A l’âge de 14 ans, Mlle Jeanne Harding était, à Bayonne, au couvent des sœurs de Lorettes (…). Son père voulut la marier contre son gré ; c’était parait-il, un père inflexible, qui n’admettait pas qu’on résistât à sa volonté. Prise de peur, la jeune fille ne vit d’autre moyen de salut que la fuite. Un beau jour, elle escalada le mur du couvent, et, pieds nus, pour ne pas user ses chaussures, n’ayant pour toute fortune que le prix de son voyage et un sac contenant une orange, elle courut à la gare la plus voisine et grimpa dans le train de Madrid. Mais, une fois dans la capitale de l’Espagne, son embarras fut terrible. »
Bref, elle tombe sur l’affiche du spectacle d’une troupe de théâtre française, va raconter ses malheurs au directeur de la troupe qui l’embauche et l’emmène en tournée à travers l’Espagne et le Portugal.
« Et, c’est ainsi que Mlle Jeanne Harding, avant d’avoir atteint son quinzième printemps, débuta à Lisbonne, dans le rôle de Denise, du Mariage aux Lanternes, où elle eut la chance de se faire assez remarquer pour que le roi, qui assistait à la représentation, la fit demander dans sa loge. »
Les journaux racontent la suite par petites touches.
En 1877, elle est sur scène à Paris au Théâtre de la Renaissance pour la reprise de La petite mariée, opéra-comique de MM. Leterrier et Vanloo, musique de Lecocq [3].
Elle reprend la tournée des casinos de province avec une troupe théâtrale. De passage à Bordeaux, en 1880, elle met au monde une fille sans vie [4]. Les déclarants sont le régisseur et un musicien de la troupe.
En 1883, elle apparait en escrimeuse dans une soirée du banquier Osiris et en jeune première coquette au Casino du Parc à Aulus-les-Bains. En 1885 elle tient avec brio le rôle de la commère dans la Revue incohérente à la salle Kriegelstein.
Elle commence alors sa carrière dans la galanterie parisienne. En 1884 elle rencontre un certain Jules DUPUY, étudiant né à Bogota, héritier à 17 ans d’une fortune conséquente. Il l’installe dans ses meubles, lui offre voiture, bijoux, œuvres d’art… En deux ans de liaison il aurait dépensé plus de deux cent mille francs. Quand il s’aperçoit qu’il n’est pas son seul amant, il met Jeanne à la porte. Elle porte alors plainte contre lui car il a conservé après leur rupture différents objets qu’il lui avait offerts. La mère du jeune homme écrit au procureur. Jeanne est déboutée de sa plainte devant le tribunal correctionnel en janvier 1887 et condamnée aux dépens [5]. En revanche, en mai 1888, le tribunal civil condamne Mme Dupuy et son fils à lui restituer les bijoux [6].
Son nouvel amant l’installe dans un magnifique appartement 26 rue Marbeuf où elle habite sous le nom de Jeanne Harding de Mesdach de Kielsem (ou de Messadet de Killesen selon les journaux). Les articles moralisateurs ou humoristiques sur les demi-mondaines qui paraissent cette année là ne manquent pas de la citer. On scrute sa bibliothèque, on la suit à la chasse ou aux concours hippiques, on commente ses diners et ses tenues de plage… Au salon de 1888 [7], sont exposés pas moins de deux portraits de Jeanne, l’un peint par Henri Gervex, l’autre par son élève Charles-Louis de Mesdach de Terkiel (l’amant ?). Elle inspire aussi Toulouse-Lautrec [8].
Mais c’est au théâtre que Jeanne veut réussir et, pour cela, elle prend des cours auprès du savant professeur de chant Ange de Trabadelo. Sa voix serait chaude et très sympathique.
En attendant de retrouver la scène, Jeanne Harding alimente encore la rubrique des faits divers en 1889 avec ses deux caniches, Carlot et Baluchon.

Une autre version raconte que les chiens furent exfiltrés vers la Belgique par un procureur du Roi.
Au long des années 1890 et 1891 on remarque la présence de Jeanne à la corrida, en vendeuse à une vente de charité au Cercle d’Aix-les-Bains, aux courses, dans des soirées mondaines... mais en septembre il se murmure que Jeanne Harding va débuter sur la scène du Cercle dans le rôle de Mignon. Ce sera finalement au Grand-Théâtre de Lille, puis à Provins.

Nadar fait toute une série de photos :


L’année 1892 avait mal commencé pour Jeanne : un incendie dans son appartement de la rue Marbeuf. Mais, en mars, elle obtient un vif succès dans Mignon au Casino des Fleurs à Cannes. Sa présence dans les mondanités parisiennes est toujours remarquée par la presse. Elle est engagée pour la saison suivante par le Théâtre municipal de Nice : elle devrait jouer Chérubin dans Les noces de Figaro. Le petit Marseillais annonce régulièrement ses futurs débuts dans une œuvre ou l’autre. Il semble que ce fut finalement dans Le Cid de Massenet. En février 1893 elle apparait dans Sigurd de Reyer. Les critiques sont… critiques : « que des madame Jeanne Harding […] a peut-être une voix très agréable en chambre, mais au théâtre elle ne présente mouvements de bouche ».
En cette année 1893, le nom de Jeanne Harding apparait de nouveau dans la chronique des tribunaux, et tout d’abord comme victime… d’une escroquerie au mariage ! Un dénommé Bidart-Hayères s’était fait une spécialité de soutirer de l’argent à des filles galantes aux quelles il promettait le mariage. Elles seraient plus d’une dizaine à être tombées dans le piège [9]. Jeanne est citée dans la liste mais son cas n’est pas explicité.
A la même époque Jeanne Harding se chargeait d’initier à la vie parisienne un jeune prince japonais du nom de Kotohito-Kan’In [10] que sa famille rappela bientôt à Yeddo, histoire de couper court à ses prodigalités. Il avait commandé à la lingère Fanny Vincent quelques 64 000 francs de dentelles, bas de soie, chemises, jupons, etc. pour la belle qui fit une commande complémentaire. Si la famille du prince paya bien la commande initiale, Jeanne refusa de s’acquitter d’une facture supplémentaire pour des biens inclus selon elle de la note du prince. La lingère porta donc l’affaire devant le tribunal civil [11]. Le tribunal condamna Jeanne à payer après avoir réduit la facture jugée excessive [12].
Un autre fils de famille, Félix Giroy, avait souscrit un billet de 150 000 fr. à la demi-mondaine qui le négocia auprès d’un banquier. Le conseil judiciaire du jeune homme refusa de payer et saisit le tribunal avant de conclure un règlement amiable.
Encore quelques apparitions sur scène à Nice et à l’Odéon et voici Jeanne engagée pour trois ans à l’Opéra-comique. Le 22 février 1894 elle y fait ses débuts dans Phryné, de Saint-Saëns. Scandale ! Dés son entrée en scène, Jeanne est accueillie par des sifflets stridents. Le public proteste contre les perturbateurs qui sont expulsés de la salle. Quand le calme revient Jeanne, imperturbable, peut chanter le premier acte mais, quand le rideau descend, s’abat une pluie de projectiles, fruits et légumes divers ainsi qu’un lapin et une morue ! Deuxième acte, nouveau tumulte. Puis le calme se fait et, bien que dans un tel vacarme il était sans doute difficile de juger du talent de Jeanne, le public lui fait une ovation. Le lendemain Saint-Saëns lui envoie des fleurs. On apprendra que Jeanne a été victime d’une cabale montée par une comtesse d’Estanges qui l’accuse d’avoir séduit et ruiné l’époux dont elle a depuis divorcé. Elle avait réservé 50 places distribuées à des amis et à des chahuteurs rémunérés. La deuxième audition est encore mouvementée, avec le lâcher de deux pigeons [13]. Les jours suivants se passent sans incident mais le spectacle s’interrompt le 4 mars en raison d’une angine de la chanteuse. Il reprendra le 9 sous les applaudissements du public. La presse multiplie les billets de soutien. On en parle jusque dans le New York Herald.
Le Figaro illustré publie un article sur La femme de théâtre [14] avec une galerie de photographies en couleurs de ces dames chez elles mais en costume de scène. Jeanne y figure en Phryné à côté de Réjane, Sarah Bernardt...

Le reste de l’année 1894 Jeanne continue de se produire dans les banquets et galas de bienfaisance. Elle vend sa collection de tableaux à l’Hôtel Drouot mais n’en tire pas les sommes attendues. Elle perd dans la rue une broche en émail et diamant et promet une récompense à qui la rapporterait. Elle répète Manon de Massenet [15] qu’elle interprétera en mars 1895 au Grand-Théâtre de Rouen. Saint-Saëns lui dédicace une mélodie.

En mai 1895 elle part pour Saint-Pétersbourg où elle donnera une série de concerts : Phryné, Manon, Roméo et Juliette… En septembre elle est de retour à Aix-les-Bains pour Roméo. Elle devait aussi y jouer dans Le Carillon mais elle disparait le jour de la première. Désarroi des auteurs, fureur du directeur, pas de nouvelles de la fugitive avant qu’elle n’évoque des « raisons particulières » qu’elle ne dévoile pas à la presse… Celle-ci est pleine d’hypothèses sur ses futurs rôles mais Jeanne ne fait que des apparitions fugaces lors de soirées pour différentes œuvres.
En avril 1896 on apprend son engagement au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Les soirées succèdent aux soirées, les procès aux procès… Cette fois c’est son sellier-carrossier qui réclame à Jeanne le reliquat d’une facture vieille de plus de 10 ans. Il est débouté. Jeanne rejoue Phryné à Aix-les-Bains devant Saint-Saëns et reçoit des propositions d’engagements à Londres et New York. Jeanne figure bien sur la liste des chanteuses du Théâtre de la Monnaie mais, indisposée, elle se fait attendre. Elle y parait finalement dans La Traviata, et encore Phryné.
La presse française est évidemment moins au fait de ses prestations outre-quiévrain mais elle ne manque pas de signaler sa présence occasionnelle à l’hippodrome de Longchamp.
Fin 1897 Jeanne revient à la une des journaux : elle se marie et liquide son passé !

La vente des bijoux est un succès [16] mais qui est ce « grand personnage des Flandres » avec qui elle va convoler ? Il est banquier, négociant ou industriel selon les articles, mais toujours riche. Son nom ne filtre pas dans la presse.
Le mariage a lieu le 29/11/1900 à Strombeek-Bever dans le Brabant flamand [17]. L’heureux élu se nomme Paul Amé Jozef Gisleen DU JARDIN. Il est né à Molenbeek-Saint-Jean le 14/10/1869, fils d’Adelson Eugeen Jan Baptist Jozef DU JARDIN (décédé à Bruxelles le 24/12/1897) et de Eliza Adolfina Maria Jozefa DAENSAERT (domiciliée à Bruxelles). L’acte nous permet de découvrir la signature de Jeanne Joséphine.

Strombeek-Bever, à 9 km au nord de Bruxelles, abrite la maison de campagne du couple qui fait des allers-retours avec la capitale. C’est ainsi que la voiture de Mme Du Jardin se retrouve début novembre 1903 broyée entre deux tramways. Jeanne est grièvement blessée. Rétablie, elle va passer l’hiver 1904 à Monte-Carlo à l’Hôtel Beau-Rivage.
Le couple divorce en janvier 1906 à la demande de l’époux… qui se remariera deux mois plus tard. Jeanne semble conserver la maison de Strombeek mais elle voyage beaucoup. On la trouve en septembre 1906 à Biarritz, en mars 1907 au Grand-Hôtel de Monte-Carlo et en mai 1908 elle est en Italie. C’est alors que son château brule, 500 000 francs de pertes au moins.
Elle se fait rare dans les gazettes. Elle participe à quelques matinées : par exemple, en 1911 chez Mme Pradon ; en novembre 1914 à Biarritz au profit des réfugiés belges.
Après guerre Jeanne n’est plus mentionnée que pour ses dons à différentes œuvres ou son soutien à un raid aéronautique. Elle offre un étui à cigarettes en or comme Trophée Souvenir du Meeting d’aviation de Nice en 1922
[18].
En juin 1925, elle passe une petite annonce dans L’intransigeant : elle a perdu sa petite chienne, un loulou blanc du nom de « Phryné », près du lac du Bois de Boulogne. Elle réside alors à Paris, 46 avenue de Tokio [19] mais pas pour longtemps.
Cette année-là elle achète en effet un terrain à Nice dans le lotissement du « Parc Carabacel ». Elle y fait construire une maison de villégiature, la Villa La Ramure [20], puis en 1930 l’immeuble résidentiel, Le Mirage [21], dont elle occupe le premier étage.
En décembre 1933 Jeanne est hospitalisée à la clinique du Belvédère [22] pour subir une opération. Le 23, elle y fait venir son notaire, Me RASTOIN, pour dicter ses dernières volontés [23]. Elle déshérite sa sœur Eugénie et désigne comme légataire universelle Marie HIRIGOYEN, épouse de Jean Victor CARRICA menuisier à Bayonne. C’est une cousine germaine de Jeanne dont on ignorait l’existence jusqu’à ce testament. Leurs relations sont un mystère. Marie n’était pas encore née quand Joséphine a quitté Bayonne. Il y a aussi un legs de 5000 francs pour son secrétaire, la même somme pour son chauffeur. Sa femme de chambre et sa cuisinière hériteront conjointement de l’appartement de la villa du Mirage où elle habitait. Jeanne prévoit aussi des legs à différentes institutions religieuses. Pour le repos de son âme ?
Elle décède le 30 décembre.

La plupart des journaux se souviendront d’elle à l’heure de publier l’annonce de son décès. Jeanne voulait être inhumée à Bayonne, sa ville natale mais il fallut une dérogation, le règlement du cimetière réservant son accès aux morts dans la commune.
La légataire accepte l’héritage sous réserve d’inventaire. En avril 1934 les immeubles dépendant de sa succession sont mis en vente à Nice. Les legs sont délivrés en janvier 1935.
En 2014 La ville de Bayonne donne son nom à un giratoire [24] à l’intersection du chemin de Sainsontan et du chemin de Hargous mais aucun panneau ne semble avoir été posé…











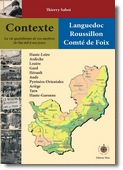


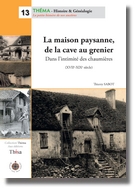


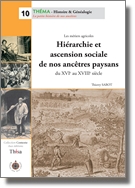


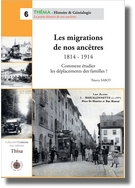
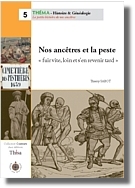


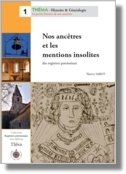


 Sans famille… et pourtant ! Quelle famille !! (2e partie)
Sans famille… et pourtant ! Quelle famille !! (2e partie)



