Georges avait même deux fiches matricules. La première a été établie dans la Nièvre [2]. En 1903 il est cultivateur à Saint-Benin-d’Azy. L’année suivante il part faire son service militaire au 10e bataillon de chasseurs à pied. Il est démobilisé en 1907 et s’installe à Soulaines [3] dans l’Aube. Il devient commis d’un marchand de vin et se marie le 14 octobre 1908 avec une fille du coin, Jeanne Marie MACHERÉ. Ils ont un fils en 1910 et Georges part à la guerre en 14. Une nouvelle fiche matricule [4] a été établie dans l’Aube. On y retrouve les péripéties de la guerre, blessures, hospitalisations, désertion avec circonstances atténuantes jusqu’à sa démobilisation en novembre 1919.
Revenons-en au début. Georges est donc né le 7 mai 1883 à Paris chez une sage-femme, rue Gay-Lussac. Sa mère, Marie Eugénie HARDIN est papetière. Elle a 17 ans.
Le 12 mai Georges est admis à l’Hospice des Enfants Assistés sous le matricule 72029 [5]. Son dossier ne nous dit rien des placements de l’enfant, a priori dans la Nièvre, mais il nous en apprend davantage sur sa mère.
La mère de Georges
Dans ce dossier Marie Eugénie HARDIN se déclare donc âgée de 17 ans, ouvrière papetière, née à Pau et résidant boulevard Montparnasse, célibataire et abandonnée par le père de son enfant. Elle serait arrivée à Paris trois ans auparavant pour être domestique. Depuis 6 mois elle serait logée par charité par un M. Lheureux, élève en pharmacie. Son père, François HARDIN, et sa mère, Jeanne Marie ERIGOYEN habiteraient Pau mais elle en est sans nouvelles depuis 2 ou 3 ans.
A Pau, on ne trouve aucun acte de naissance à son nom. Comme souvent lors des abandons d’enfants, la mère n’a pas dit toute la vérité. Une recherche sur le nom de son père renvoie à un mariage [6] entre François HARDIN et Jeanne HIRIGOYEN à Mouguerre dans les Pyrénées-Atlantiques le 1er juin 1857. Jeanne est de Mouguerre, mais François est de Bayonne. C’est dans cette ville que l’on trouve la naissance de leur fille Marie Eugénie le 14 juillet 1865. A priori seule la ville d’origine avait donc été modifiée.
Que va devenir Marie-Eugénie après cette mésaventure ?
A priori elle ne laisse pas de traces entre 1883 et 1890, date à laquelle elle se marie au Perreux, aujourd’hui dans le Val-de-Marne, avec Jean Léon JANSSENS. Désormais sa vie sera liée à ce personnage haut en couleurs sur lequel nous reviendrons plus tard.
Les grands-parents
François HARDIN et Jeanne HIRIGOYEN se sont donc mariés à Mouguerre dans les Pyrénées-Atlantiques le 1er juin 1857.
François est calfat [7]. Il a été « trouvé exposé » à Bayonne le 19 juillet 1832, déposé au tour de l’hospice civil de la ville. Un procès-verbal est dressé relatant l’exposition de l’enfant et décrivant son habillement. Il est admis à l’hospice et on lui donne le nom de François HARDIN a priori sans justification. Il semble que la pratique de cet établissement était d’attribuer aux enfants des noms qui ne dérangent pas la population locale afin qu’il ne soit fait aucun lien avec les familles « respectables » de la ville. Le nom de HARDIN répond bien à ce souci : à l’époque on ne le trouve que dans l’Ain et la Haute-Saône.
Jeanne HIRIGOYEN est quant à elle née à Mouguerre le 3 juin 1827. Son père y est cordonnier et sa famille y était déjà implantée au début du 17e siècle [8]. Contrairement à François, ni Jeanne, ni ses parents ne savent signer. Jeanne sera successivement couturière et bordeuse de souliers.
Jeanne et François s’installent à Bayonne. Ils habitent longtemps au 38 rue Pannecau, puis au 9 rue Marengo et finalement au quartier Lachepaillet.
Le couple aura 6 enfants à Bayonne :
- Jacques Louis né le 24 aout 1857 [9] et décédé en 1859 ;
- Marceline née le 13 janvier 1859 [10] ;
- Catherine Emilie le 22 mai 1861 [11] et décédée en 1872 ;
- Joséphine le 20 septembre 1862 [12] ;
- Henri Pierre le 19 février 1864 [13] ;
- et finalement Marie Eugénie en 1865.
Tous deux décéderont à Bayonne en 1902, François, devenu charpentier de marine, le 18 novembre 1902, et Jeanne le lendemain.
Les oncle et tantes de Georges
Seule l’ainée des enfants du couple est restée dans la région. Marceline est une lisseuse [14] de 23 ans quand elle se marie à Bayonne le 18 novembre 1882 avec Pierre CAZAUX [15]. Fils d’instituteur, celui-ci a 22 ans et est valet de chambre à Biarritz. Le 24 février 1883 Marceline y met au monde une petite fille prénommée Amélie Françoise [16] et elle y décède en novembre de la même année [17].
A cette période Joséphine et Eugénie ont déjà fuit le foyer familial depuis plusieurs années. On a vu qu’Eugénie était partie à Paris vers 1877, on verra que Joséphine parcourt l’Europe depuis 1876 sous le nom de Jeanne HARDING. Un article spécifique lui sera consacré.
Henri, lui-aussi, est parti : il a devancé l’appel sous les drapeaux et s’est engagé début 1882 pour 5 ans dans le 1er régiment de chasseurs d’Afrique [18]. Il est nommé caporal en décembre 1884. Démobilisé, il s’installe à Alger en 1887. Comptable, il devient gérant de la succursale de la « Maison Veuve BERTOMEU et Cie » à Constantine. Antoine BERTOMEU était marchand de tabac. Sa fille Léonore Antoinette Joséphine Rafaele avait épousé à Saint-Eugène le 24/11/1887 Nicolas MELIA employé de commerce. Et Henri épousa Jeanne Catherine MELIA, sœur de Nicolas.
Le couple ne semble pas avoir eu d’enfants. Tous deux décèdent à 39 ans, lui en 1902 à Constantine [19], elle l’année suivante à Mustapha [20]. Malgré quelques erreurs, les faire-part publiés dans la presse montrent que certains liens avaient été maintenus entre les deux rives de la Méditerranée.

Quelques années plus tard les Cigarettes Mélia offriront à leurs clients un chromo représentant… Jeanne Harding !

Le beau-père, Jean Léon JANSSENS, roi des escrocs ?
Jean Léon Janssens est né le 29 mai 1859 à Paris et c’est son acte de baptême à la paroisse Saint-Denis-du-Saint-Sacrement qui servira à reconstituer son état-civil. Son père, Frédéric, est belge mais Jean Léon deviendra français en vertu de l’arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 1891.
Léon se marie une première fois le 6 mai 1882 à Paris 15e. Il est alors « non naturalisé », employé et habite chez ses parents 69 rue d’Oberkampf. La mariée, Clotilde Rosalie DEBRAY, est une couturière de 20 ans, parisienne [21]. Le divorce sera prononcé six ans plus tard au profit de l’époux.

On ne sait ni quand, ni comment les chemins de Marie Eugénie HARDIN et de Jean Léon JANSSENS se sont croisés. Ils se sont installés ensemble au Perreux, 184 avenue de Bry. Il est alors caissier, elle sans profession. Ils se marient le 6 septembre 1890 [22]. Ils ont domestique et cocher [23].
On leur connait plusieurs adresses au Perreux : Villa Florian (1894), 142 avenue de Bry (1895). Le couple découvre Yport en Seine-Inférieure vers 1893 : il y passera ensuite tous ses étés. Les bains de mer se développent. Yport devient une destination touristique…
En 1895, ils changent de régime matrimonial et optent pour la séparation de bien. Cela leur sera bien utile plus tard. Jean Léon est alors qualifié d’ex-banquier.
Il s’est en effet lancé dans les affaires l’année précédente. Avec Henri-Léon ROY et plusieurs commanditaires, il a créé la « Société Roy, Janssens et compagnie » dont la fonction serait de négocier en Bourse. Léon n’hésite pas à se déplacer pour trouver des clients en province.
La société disparait sans doute assez vite et, en juin 1897, Léon et un commanditaire créent une nouvelle « Société Léon Janssens et Cie » toujours pour agir en Bourse. En parallèle il est publiciste [24] et professeur de comptabilité au « Cercle des conférences commerciales » de Paris. Cela lui vaut d’être nommé « officier d’académie » [25] au JO du 21 juin 1898.

Quant à la société, elle sera liquidée en décembre 1899. D’après sa fiche matricule, Jean Léon déménage alors à Bruxelles…
Léon a acheté des terrains à Yport. A partir de 1898, Il y fait construire villas et chalets par l’architecte Leblois : il y aura la villa « Eugénie », la villa « Les Roses » [26], le chalet « Le Coteau », « Le Nid », etc. Il y en aura 14 au total. Il est chroniqueur à la « Gazette d’Yport », journal balnéaire hebdomadaire, où il vante les attraits du village et sa situation auprès des parisiens. Il devient même conseiller municipal.
Mais c’est à Paris qu’en 1901 il monte la société en commandite du « Comptoir financier franco-belge ». Il ne lésine pas sur la publicité, directe ou rédactionnelle. L’article de La Nation est particulièrement savoureux.
Mais la publicité est contrebalancée par l’avis des clients. Des plaintes sont déposées en 1904.

La société est liquidée. Que croyez-vous qu’il fit ? Une banque, évidemment !
La « Société Léon Janssens et Co. », créée en décembre 1904, prend cette fois la dénomination de « Société générale de crédit départemental ». Léon apparait toujours comme résident au Perreux mais, comme ses sociétés précédentes, le siège de la banque est à Bruxelles avec bureau à Paris. La Nation publie toujours des articles dithyrambiques sur Léon, Ruy Blas se montre, à raison, beaucoup plus critique. Le tribunal de commerce de la Seine prononce la faillite de la société en octobre 1906 et, pour lui, Jean-Léon Janssens est sans domicile connu... Condamné à 3 ans de prison, il s’est réfugié à Bruxelles et fait appel. Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 27 mars 1907 confirme le jugement.

C’est alors que la séparation de biens des époux montre son utilité. Sur la revendication de Mme Janssens, un accord intervient avec le syndic pour laisser à l’épouse les immeubles et au syndic tous les meubles sauf une créance Chouard. La transaction est homologuée par le tribunal le 3 septembre 1907.
Alfred Chouard est entrepreneur de travaux publics de Bihorel-les-Rouen où il possède trois briqueteries. La créance est donc directement en rapport avec les villas d’Yport. Pour récupérer sa créance, il se tourne vers le tribunal du Havre qui condamne les Janssens à la saisie réelle d’immeubles situés à Yport, Saint-Léonard et Vattetot, saisie qui est convertie en vente aux enchères amiable par le ministère de Me Ronceray notaire à Fécamp.

Une première adjudication a lieu le 21 janvier à la mairie d’Yport. Elle comporte 7 lots de terrains et une petite maison. Une nouvelle adjudication publique eut lieu le 9 août 1908 : une maison située Grande Rue ; les maisons 12, 14, 16, 18 et 20 rue Alfred Nunès (qui ne trouvent pas d’acquéreur) ; 5 maisons et 3 terrains route de Vaucottes. Les ventes continuent : la « villa Les roses » et son mobilier, des terrains, les maisons de la rue Alfred Nunès, 2 maisons route de Vaucottes… Et en novembre 1908 Eugénie peut rembourser Chouard et ses deux autres créanciers. Elle vendra encore une maison en 1910 et un terrain en 1913.
En revanche elle rachète en 1920 une des maisons de la route de Vaucottes. Le couple s’y installe et y est recensé en 1926. Avec eux, vivent une domestique et sa fille.
C’est par la « Table des successions et absences » de Fécamp que l’on apprend le décès de Jean Léon le 11 janvier 1930 à Cambo dans les Basses-Pyrénées alors qu’il est toujours domicilié à Yport. Le détail de la succession serait intéressant à connaitre. Apparemment il y a renonciation des héritiers… Toutes les dettes ne devaient pas être apurées.
En 1936 [27], Marie Eugénie, veuve Janssens est toujours à Yport avec la même domestique et sa fille. La route de Vaucottes est devenue la rue Ernest Lethuillier. Elle y décède le 21 mars 1937. La TSA indique qu’elle a fait un testament. Il reste à le trouver…











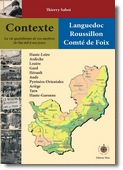


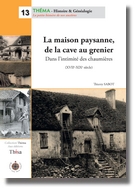


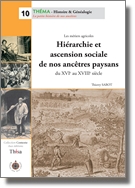


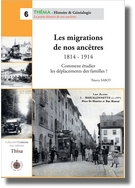
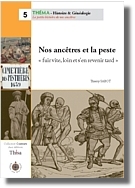


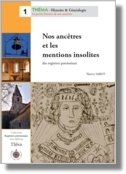


 Sans famille… et pourtant ! Quelle famille !! (1e partie)
Sans famille… et pourtant ! Quelle famille !! (1e partie)






