En faisant boire des chevaux
Abreuver les bêtes directement à l’eau de Seine semble une évidence.
Les cales des passages d’eau sont généralement divisées en deux largeurs : une pour le bac et une pour un abreuvoir : ainsi à La Bouille où « la cale est le seul endroit où l’on puisse abreuver les bestiaux » (1822) et à Croisset sur un plan de 1832. Quand en 1820 Louis Chaillou cède un terrain pour la cale de Jumièges, il exige de pouvoir y abreuver ses bestiaux.

Les rives plates de la Seine naturelle permettent un accès facile des bêtes à l’eau même à marée basse en passant un véritable estran, sans qu’on ait besoin de les mener. Les digues, construites à partir de 1848 mais étalées sur une longue période, forment une pente bien plus difficile à franchir. Nombreuses sont ainsi les demandes d’escaliers pour descendre abreuver les bestiaux.
Cela n’est pas sans risque. Le maire de Vatteville-la-Rue demande en 1881 que les escaliers des digues aient 1,20 mètre de large et une moins forte pente « de manière à permettre aux bestiaux qui viendraient à tomber à la Seine de remonter aisément ». On prévoit en 1889 à Norville de clore le marais communal « afin d’empêcher les bestiaux de tomber à la Seine ». Le 31 août 1900, Amédée Achille Chouland se noie à Petiville en tendant de récupérer un veau tombé à la Seine.
Le 5 mai 1807, Pierre Nicolas François Roussel, 24 ans, se noie à Canteleu en conduisant boire son cheval.
Le 5 juin 1811, le douanier Pierre Nicolas Sulpice Dubosc, 20 ans, tombe de son cheval mené boire, à Jumièges.
Le 9 septembre 1911, un détachement d’artillerie, avec 200 chevaux, s’arrête à Duclair pour les abreuver à la cale du bac. On les amène par groupes de 8 ou 10. Tout se passe bien pour le premier mais au deuxième un cheval glissant sur la vase se cabre et fait chuter son cavalier. Le soldat Rhétoré, 19 ans, se noie et le lieutenant Dusannier, 29 ans, porté à son secours connait hélas le même sort.
Le lundi 12 juin 1922, c’est un attelage de deux chevaux que Jean Tridout entend abreuver à la cale de Caudebec « malgré l’avertissement de personnes qui tout de suite avaient compris le danger couru ». « La Seine était base, les pavés n’allaient pas aussi loin, les chevaux perdirent pied et s’engouffrèrent avec la voiture et le conducteur resté sur son siège ».
En jetant des ordures
Jeter les ordures est pratique commune. La corvée semble dévolue aux domestiques.
On s’y débarrasse aussi du contenu des seaux hygiéniques. En 1828, un voyageur remarque à Villequier « des constructions d’une nature toute particulière suspendues au-dessus des eaux, presque devant chaque maison ». Les water-closets apparaissent ainsi comme un formidable progrès : « le produit personnel est dilué dans un chasse de dix litres d’eau » et « par suite de la pente de la canalisation et du jeu des marées et des courants, toutes les matières sont entraînées au fleuve sans que jamais il n’en reste rien sur la berge ni que l’on perçoive de mauvaise odeur » ; cela « réalise un sérieux progrès sur la pratique habituelle qui consiste à déverser directement les matières brutes dans le fleuve » (Villequier, 1911).
Pourquoi le commis épicier Philibert Lefebvre, 14 ans, qui a l’habitude chaque soir de vider un seau d’eaux grasses dans la petite rivière la Planquette préfère ce soir du 29 novembre 1868 aller jusqu’à la Seine ? S’inquiétant, son patron fait faire des recherches et on en retrouve le corps quelques heures plus tard.
Nous sommes toujours à Caudebec. Marguerite Gomont, employée par l’Hôtel du Siècle, 19 ans, tombe à l’eau en y jetant un seau d’ordures. Par bonheur, Joseph Aubert, matelot d’un bateau des Ponts & Chaussées amarré non loin est courageux : il plonge tout habillé et réussit à la tirer d’affaire, ce qui lui vaut une médaille d’argent.
Remplaçant le même office, le 1er décembre 1906, une fille servante – son nom n’est pas précisé – d’un pâtissier de Duclair descend un escalier du quai et trébuche à la dernière marche. Un boulanger passant par-là eut heureusement le réflexe de la rattraper in extrémis « plus tremblante de peur que mouillée par l’eau ».
Le 29 août 1917, la bonne d’un pilote de Villequier – son nom n’est pas donné – fait un faut pas en jetant des ordures. Félix Persil, « malgré que la Seine fut démontée » réussit « avec beaucoup de difficultés à la saisir et à la retirer de sa position critique ».
En puisant de l’eau
 L’eau de Seine peut servir à de nombreux usages domestiques et peut-être est-elle-même buvable ? – c’est une bouteille que voulut remplir Eugène-Henri Duchemin à La Mailleraye le 19 mai 1917. Louis Chaillou, que nous avons déjà rencontré, exige encore « d’aller [à la cale de Jumièges] chercher l’eau toutes fois que je le jugerai à bras ou en charrette » - il s’agit peut-être de la tonne remplie traditionnellement au pucheux.
L’eau de Seine peut servir à de nombreux usages domestiques et peut-être est-elle-même buvable ? – c’est une bouteille que voulut remplir Eugène-Henri Duchemin à La Mailleraye le 19 mai 1917. Louis Chaillou, que nous avons déjà rencontré, exige encore « d’aller [à la cale de Jumièges] chercher l’eau toutes fois que je le jugerai à bras ou en charrette » - il s’agit peut-être de la tonne remplie traditionnellement au pucheux.
De l’eau en abondance est nécessaire aux briquetiers de Barneville-sur-Seine et du Landin. Ils demandent en 1848 que des escaliers à travers le nouveau chemin de halage remplacent les abreuvoirs qui leurs servaient à puiser de l’eau mais aussi à abreuver leurs bestiaux et à aborder leurs bateaux pour enlever leurs briques.
C’est en allant puiser de l’eau à Anneville-sur-Seine, le 26 novembre 1887, que la dame Savary est surprise et enlevée par le flot sur 150 mètres, son corps n’est retrouvé qu’après deux heures.
Le 17 février 1891, Lefrançois, maire du Mesnil-sous-Jumièges, est également emporté par une lame du flot en puisant de l’eau au bord de son quai. Plus chanceux, « il put s’accrocher aux ronces du talus et se tirer de ce bain forcé ».
Le lundi 28 août 1933, Ernest Beaudoin, à Saint-Nicolas-de-Bliquetuit puise de l’eau à l’aide de seaux. Il a pour cela placé au long de la berge endiguée une échelle attachée à un arbre – notons encore une fois la difficulté des digues pour l’accès à l’eau. On peut penser que M. Beaudoin procédait à marée haute et remplissait une citerne ou une tonne sur la rive. Mal fixée, l’échelle tombe, entraînant Beaudoin qui se noie.
Ajoutons que c’est en allant puiser un seau d’eau à la digue vers Norville, le 10 août 1913, que Louise Dumont, 13 ans et bonne de M. Evron, cantonnier à Villequier, découvrit le cadavre d’un homme « en complet état de putréfaction ».
En se lavant les pieds
Le 19 juin 1887, Léon Lecointre, facteur de 20 ans, est retrouvé noyé près du phare de Caudebec. « On suppose que ce jeune homme aura voulu se laver les pieds la veille au soir et que pris d’un étourdissement il sera tombé à la Seine ».
Le 13 juillet 1914, vers 13 heures, le jeune Emile Gontier se lave les pieds à la cale d’Heurteauville, assis sur un seau retourné. Son corps est retrouvé deux heures plus tard.

C’est en lavant ses bottes que Dominique Delahaye, 13 ans, est emporté par une lame. Une plaque près de là commémora longtemps sa mémoire.
En faisant un besoin naturel
Dans la nuit du dimanche au lundi 16 janvier 1887, les frères Henri et Louis Andrieu, un peu émus – lisons ivres -, tentent de rejoindre Norville. Louis « eut besoin de s’arrêter un instant ». Son frères « entendant presque aussitôt la chute dans corps dans l’eau » se précipice et réussit à la retirer de l’eau. Il put continuer son chemin.
Le 15 août 1898, Valentin Boquet s’isole en sortant du théâtre. Son corps est retrouvé à Villequier le 19 : « on suppose qu’il sera tombé accidentellement la Seine en satisfaisant un besoin, car il était pris de boisson ».
Le 24 septembre 1922, Georges Quertier se joint à la fête Saint-Matthieu de Caudebec. Vers 11 heures du soir, il s’isole de la foule pour satisfaire un besoin naturel et s’installe au bord du quai quand un mauvais plaisant lui assène un coup de poing qui le précipite dans le fleuve. Il mit huit jours à s’en remettre.
C’est en lavant des moutons, à Aizier le 23 juin 1838, pour le compte du sieur Topsent, cultivateur à Bourneville, qu’Alphonse Lecompte tombe à Seine.
Le 14 avril 1916, deux soldats cantonnés en forêt de Brotonne lavent un lourd camion automobile à la cale de Caudebec. Au retour, les roues patinent : « le véhicule et son conducteur disparurent sous flots ».
C’est en chassant le canard sur la rive de Saint-Nicolas de Bliquetuit, le 1er avril 1895 que le sieur P.D. se prend les pieds dans une moise – sans doute au débouché d’un canal de drainage – et se retrouve dans l’eau jusqu’à la ceinture. Il s’en tire seul avant même l’arrivée de douaniers accourus à ses cris.
En plus des registres d’état civil et de la presse :
- Archives Départementales de la Seine-Maritime : 3S112, 3S114, 3O1694.
- Archives Départementales de l’Eure : 23S2
- Jérôme Chaïb, L’eau en Normandie, 2021.
- Jean Pierre Derouard, Un fleuve et ses riverains, des riverains et leur fleuve, 16 paroisses riveraines de la Seine maritime au 18° siècle, Cahiers Léopold Delisle, tome XXXIV, 1985, pp 9-58.
- Jean Pierre Derouard, Bacs et passages d’eau de la Seine en aval de Rouen, 2003.
- Eusèbe Girault de Saint-Fargeau, Histoire naturelle et dictionnaire géographique de toutes les communes de Seine-Inférieure, 1828.
Illustrations :
- Vaches à la cale du bac de Jumièges, carte postale ancienne.
- Bord de Seine au Landin, 30 juin 2010.
- Ancienne plaque à la cale du bac de La Mailleraye.











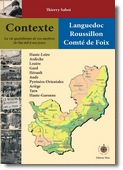


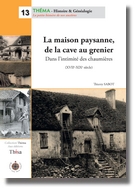


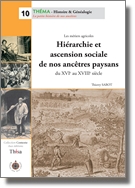


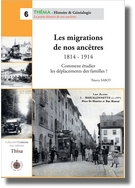
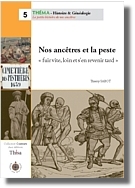


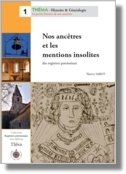


 Les noyades du quotidien en bord de Seine
Les noyades du quotidien en bord de Seine