 Nouméa le 26 octobre 1879
Nouméa le 26 octobre 1879
Chers collègues et amis
Je suis persuadé que certains d’entre vous, à qui j’ai promis de donner de mes nouvelles dès mon arrivée à la Nouvelle Calédonie ont déjà fait de faux jugements sur moi car je sais que celui qui n’est pas patient dit de celui qui fait des promesses c’est un ingrat. Il ne nous donnera pas des ses nouvelles. Cependant je pense qu’il y en a d’autres qui n’ont jamais eu cette idée-là de moi.
Eh bien non, je ne veux pas qu’un seul de mes amis puisse dire que je suis un ingrat ; je veux au contraire lui prouver qu’une chose promise est due, comme jadis la terre d’Egypte fut donnée aux Hébreux.
Je vais donc essayer de vous faire, tant bien que mal le récit de cette traversée si redoutable.
En attendant le vaisseau – « Transport la Loire » –, sorti du port de Brest le 1er juin, nous fûmes placés en subsistance à la Gendarmerie maritime de Rochefort du 29 mai au 6 juin, jour où notre transport est arrivé sur la rade.
Le 6 juin, à 2h du soir, nous fûmes conduits sur la rade, par un petit vapeur appelé « le travailleur » qui se trouve à 22 ou 24 km de Rochefort.
Il y avait à peine une heure que nous étions sortis du port, qu’un accident regrettable a ému les passagers car les matelots habitués à voir cela souvent ça ne leur produit aucun effet. Dans le sillage de notre bateau, suivait une petite canonnière, montée par 5 hommes qui a sombré d’un coup, sous les eaux de la Charente.
Immédiatement, l’on mit trois canots à l’eau pour secourir ces malheureux qui se débattaient dans les flots. Deux de ces infortunés n’ont pu être retrouvés.
Après 10 ou 15 minutes d’arrêt, nous continuâmes notre chemin et deux heures après, nous pûmes contempler le bateau sur lequel nous dûmes passer 4 mois !
La rade était calme. Le bateau se trouvait entre l’île d’Aix et deux forts construits par Richelieu montrant leurs trois rangées de bouches béantes prêtes à vomir la mort sur les téméraires qui tenteraient de s’en emparer.
Sur la rade où nous nous trouvions par un soleil brillant, nous avions du côté de la terre un coup d’œil ravissant.
L’île d’Aix, elle-même entourée de rochers escarpés formant une muraille formidable doit rendre le débarquement impossible pour une troupe ennemie qui tenterait d’y faire une descente.
Sur le versant de la côte avoisinant l’embouchure de la Charente, on y voit des prairies ennuyeuses, verdoyantes, renfermant des troupeaux de bœufs considérables.
La vue de ce géant rendait heureux ; on oubliait que sur cette grande route, la mer deviendrait le tombeau de quelqu’un d’entre l’équipage. La mort frappe d’un pied indifférent.
Une fois à bord, on nous donna notre numéro et le lit traditionnel de la marine.
Le 7 nous mîmes à la voile et jusqu’au 9 nous n’éprouvâmes aucun désagrément de ce mal si redouté ; mais le 10 le vent commença à donner et à nous secouer de telle sorte que chacun commença à payer son tribut à la mer.
Bien que je sois certain de rester au-dessous de la réalité, je vais essayer de vous donner une idée de ce mal si redoutable. Le mal commence par un mal de tête affreux, puis des maux de cœur, suivis de quelques nausées, qui sont les précurseurs du dégueulage (pour parler marin) qui dure de 4 à 8 jours. Si encore l’on avait quelque chose pour vomir, on ne serait pas si gêné, mais quelquefois la nausée vous surprend, alors que vous cherchez un coin caché pour vous soulager mais hélas ! souvent vous n’avez pas le temps de faire un pas que vous êtes obligé de satisfaire le besoin présent. Il arrive un moment où le mal se fait tellement sentir que les douleurs contortionnelles sont atroces ; vous n’entendez plus. Rien ne fait impression sur vous, vous restez inertes, abattu, sans courage et sans éprouver le besoin de manger, voilà le mal de mer !
Si la Loire est venue sur la rade de Rochefort, ça a été pour prendre 354 forçats qui étaient à l’Ile de Ré qui n’ont pas fait du tout mon bonheur car ils m’ont donné du fil à tordre pendant la traversée ; pas trop à moi mais à mes gendarmes qui n’ont eu que 2 et 4 heures de repos entres les factions.
Ces rejetés du sein de la société ont pris place dans des cases disposées pour la circonstance qui ont servi à transporter à la Nouvelle Calédonie les condamnés de l’insurrection de Paris.

- Quelques noms de forçats embarqués
- "Tablettes des deux Charentes" 14 juin 1879
Parmi ces figures plus ou moins criminelles il n’y avait pas de personnages très importants, il y avait 4 curés et 3 frères ignorantins, la plupart, condamnés aux travaux forcés pour viol, attentat et outrages publics à la pudeur ! vingt cinq à 30 pères de familles pour viol sur leurs filles, bon nombre d’assassins précoces, entre autre les deux fameux Barré (ou Barès) et Perrot (ou Perrau), âgés de 19 ans qui resteront à jamais gravés dans les mémoires de ceux qui ont lu leur procès.
Quand j’ai demandé à Barré (ou Barès) ce qu’il avait fait pour l’amener au bagne si jeune, il m’a répondu avec ce cynisme incroyable : « j’étais à Paris, je gagnais 5 francs par jour qui ne me suffisaient pas pour m’amuser. J’ai accompagné un camarade (Perrau) chez ses grands-parents à Auxerre où nous fûmes choyés pendant trois jours. Un soir, les vieux nous croyant couchés dans une maison voisine, nous entrâmes et nous frappâmes les deux victimes, l’une dans la cuisine où nous avions attiré sciemment et l’autre dans son lit.
L’une donnant encore signe de vie demandait grâce à son petit-fils en lui promettant de lui donner son argent, nous lui ouvrîmes le ventre à coups de talons, mais comme la mort ne venait pas assez vite, nous lui plongeâmes un couteau dans le cœur ; nous prîmes huit cents francs dans une armoire et nous revinrent à Paris où nous fûmes arrêtés le lendemain.
Voilà à peu près dans quel sens ces coquins racontent leurs forfaits.
 Pour découvrir leurs dossiers de bagnards sur le site des Archives nationales d’Outre-Mer : Pour découvrir leurs dossiers de bagnards sur le site des Archives nationales d’Outre-Mer :Charles Gustave Perrot, matricule 11178 [1] Louis Barré, matricule 11050 [2] |
Nourriture du bord = La nourriture est plus que modeste, il faut être né dans la coque d’un bateau pour pouvoir se faire à cette nourriture qu’on peut qualifier exécrable et ensuite pour se faire aux mœurs scandaleuses qui se commettent à bord d’un bateau. Un jeune homme animé de bons sentiments qui entre dans la marine pour y faire son congé en sort perverti et rempli de vices.
Nous avons eu des bœufs jusqu’à Nouméa.
Itinéraire : je ne veux pas vous donner ici le point jour par jour, ça serait trop long je ferais un petit tableau que je placerais à la gauche de ma lettre pour que si toutefois quelqu’un d’entre vous avait une carte, il puisse en tracer l’itinéraire suivi par la Loire.
En moyenne, on ne met que 10 à 12 jours pour se rendre à Ténériffe. Comme j’ai dit plus haut, nous quittâmes la rade de Rochefort le 7 juin et 3 jours après nous étions au large des côtes d’Espagne. Là le calme plat se mit de la partie et nous fûmes forcés d’obéir à son indolence pendant quelques jours, mais le 8e jour le vent nous fit faire bonne route et le vingt trois dans la matinée, nous eûmes le loisir d’apercevoir une éminence disséminée dans l’ombre à 25 ou 30 milles à tribord qu’on nous assura être le pic de l’île de Ténériffe.
En effet, à mesure qu’on s’en approchait, l’éminence devenait moins sombre, de nouveaux pics paraissaient et enfin vers deux heures, nous commençâmes à défiler entre l’île de Palmas et la côte de Ténériffe jusqu’à Santacrus où nous mouillâmes. Sur cette côte se trouvent quelques bicoques parsemées entre les pics qu’on peut comparer à une chaine de pains de sucre.
La ville de Santacrus qui est la capitale des iles Canaries, renferme de 12 à 13 mille habitants, elle se trouve enclavée entre deux montagnes gigantesques, brûlées par le soleil.
Bien que ténériffe soit un pays pauvre ingrat au point de vue de la fertilité ; je n’ai pas eu à m’en plaindre, car je m’y suis amusé. Je vais vous dire comment. A bord de la Loire, se trouvait un lieutenant pour commander l’arrondissement de Païta (Nouvelle Calédonie). A Ténériffe, comme il est permis aux passagers d’y chasser sans permis, nous allâmes à 25 kilomètres au-delà de Santacrus passer deux jours à la chasse, avec chacun un fusil.
Nous tirâmes beaucoup de gibier composé de cailles, perdrix, et d’autres oiseaux hupés de la grosseur du corbeau que je ne connais pas.
Je n’ai pu comprendre la température de ce pays, et Santacrus il y avait 34 à 35 degrés de chaleur, et à 25 kilomètres au-delà, c’est-à-dire derrière le versant du pic le plus élevé, il y faisait plutôt froid que chaud.
Santacrus est assez joli, ses rues sont assez droites, mais mal pavées, le passage se compose de pierres ayant la forme pyramidale, ramassées sur le rivage de la mer. Elles sont posées debout et forment des pics qui fatiguent beaucoup les pieds.
A 10 et même 15 kilomètres à la ronde de Santacrus on ne voit que des rochers granitiques, ressemblant à de la lave noircie par le soleil. Le commerce de Santacrus est bien monotone je n’y ai vu rien de remarquable.
Cependant je puis dire en passant, et je vous prierai de m’excuser, que les femmes prostituées ne manquent pas, je crois que dans certaines rues on peut frapper à presque à touts les portes sans craindre d’affront.
L’Etat sanitaire du bord a été assez bon pendant toute la traversée, par conséquent nous n’avons pas eu beaucoup de morts à enregistrer mais il était temps que nous arrivions car le scorbut commençait à faire son effet. Huit hommes seulement ont été jetés à la mer = 7 forçats et un soldat de l’infanterie de marine morts d’insolation à Ténériffe. Le 1er que l’on fit passer le sabord fut un forçat que l’on trouva pendu dans la poulaine du bagne et le 2e, un arabe transporté pour politique.
| Poulaine : Fustier, 1889 : Cabinets d’aisance. Argot du bagne. On s’entassait à la poulaine (lieux d’aisance) où une pompe...fournissait en grande abondance l’eau nécessaire à ces ablutions.(Humbert, Mon bagne) La Rue, 1894 : Lieux d’aisances. France, 1907 : Lieux d’aisances ; argot des marins passé dans celui du bagne. Cet endroit est appelé ainsi parce que, sur les navires, il se trouve à l’avant du vaisseau, appelé poulaine. https://www.cnrtl.fr/definition/poulaine |
Le soldat de l’Infanterie de marine a été enterré à Ténériffe. La cérémonie fut à la fois triste et grandiose. Trois détachements de 20 hommes composés de marins, artilleurs, infanterie de marine, 15 soldats espagnols, les gendarmes libres et quelques officiers ont accompagné ce malheureux à sa dernière demeure.
A Santacrus on une singulière façon d’enterrer les morts. Voici ce que l’on fit : après les quelques paroles prononcées par le curé, que je n’ai pas plus comprises que compris la langue espagnole, on ouvrit le cercueil pour couvrir le corps de chaux avant de le descendre dans la tombe.
En sortant du cimetière, nous rencontrâmes un homme chaussé comme notre premier père portant le corps d’un petit enfant dans ses bras qu’il allait faire enterrer sans cercueil. Nous demandâmes à un Français si c’était seulement pendant la période des grandes chaleurs que l’on procédait ainsi, et si c’était l’habitude du pays d’enterrer les morts sans cercueil. Il nous répondit que pour la chaux, on ne s’en servait que pendant les fortes chaleurs, mais pour le cercueil s’en servait qui pouvait en faire la dépense.
Pendant notre séjour à Ténériffe les officiers supérieurs donnèrent un bal à bord.
Le Consul convia toute l’aristocratie du pays, ce qui fit que la soirée fut assez brillante.
Partout où nous mangeâmes le lieutenant et moi, on nous servait du vin de Madère à table, le vin rouge n’est presque pas connu.
Comme j’ai déjà dit plus haut, nous avions 354 têtes de bétail, il fallait les garder surtout au mouillage de Ténérife et en outre éviter leur contact avec l’équipage. Pour assurer la surveillance de ces scélérats, nous n’étions pas assez de monde de sorte que notre service fut pénible.
Réveil : le réveil au branlebas s’est fait en tout temps à 6 heures, 5 minutes après le café et ensuite lavage des batteries et du pont qui ne durèrent pas moins d’une heure ½.
Pendant que les matelots se livraient à ce travail, j’ose vous dire que l’on n’était pas à son aise. Dans les chaleurs et même pendant les froids supportables, je me suis toujours mis pieds-nus avec les pantalons retroussés jusqu’aux genoux.
De Rochefort jusque vers la hauteur du Cap de Bonne Espérance, nous rencontrâmes presque chaque jour des bateaux mais aucun n’est passé près de nous à moins de 3 ou 4 milles. Le 8 juillet nous vîmes à environ 4 milles à Tribord un vapeur Anglais qui nous signala par signes organisés au moyen de petits drapeaux, que le dernier rejeton de la branche Napoléonienne était mort au cap dans les premiers jours de juin. Notre Commandant a répondu qu’il le savait, qu’il avait appris cette nouvelle à Ténérife.
Depuis notre départ de Santacrus jusqu’au 15 juillet, c’est-à-dire quelques jours après avoir passé l’équateur, nous eûmes de fortes chaleurs, on n’était bien que sur le pont mais on ne pouvait y rester que la nuit, et encore l’on était dérangé à chaque instant par les manœuvres que l’officier de ¼ fait faire.
Un mois avant notre arrivée à l’Equateur, tous les savants et les intelligents du bord se mirent à l’œuvre pour faire des toiles et autres achalandages pour fêter le passage de la ligne qui est je crois obligatoire pour tous les bateaux de guerre qui passent le tropique. La représentation théâtrale eu lieu bien après le baptême.
Je m’étais bien amusé à Santacrus mais pas comme le jour de ce baptême. La veille, après la soupe, le vaguemestre, habillé en postillon eu descendu de la hune du grand mât où un bœuf travesti paré à le recevoir, l’a conduit sur l’arrière du bateau et la, entouré des autorités, le vaguemestre fit la distribution des paquets aux intéressés.
Ces lettres ne renfermaient que des phrases forgées pour la circonstance et la plupart des journaux étaient du siècle dernier.
Le lendemain Monsieur et Madame La Ligne (en rapport avec l’Equateur) (deux vieux marins habillés en sauvage) se sont présentés au Commandant et l’ont sommé de leur remettre le commandement du Vaisseau en lui disant, dérisoirement qu’il s’était trop aventuré dans ces parages, qu’il avait devant lui des récifs de coulions [3] et derrière des bancs d’andouilles à tribord et à babord des récifs de cornichons et qu’il lui était impossible de se tirer de là sans danger.
A l’instant même M. et Mme La Ligne ont fait exécuter quelques manœuvres dérisoires et la vraie rigolade a commencé.
Une grande toile contenant 3 ou 4 mille litres d’eau a reçu, en commençant par les officiers, tous les passagers au nombre de 350 à 400 qui n’avaient pas passé le Tropique. Ces passagers étaient appelés nominativement, ceux qui ne répondaient pas à l’appel, un morceau de papier sur lequel était votre nom dénaturé, servant de mandat d’amené, était remis aux gendarmes (matelots ressemblant aux canaques) qui ne tardèrent pas d’amener les réfractaires devant le juge mandant.
Avant de tomber dans la toile on montait 2 ou 3 marches puis l’on s’asseyait et le perruquier nous rasait, il avait soin de nous savonner avec du noir et au moment où il levait son grand rasoir en bois, un autre - l’aide du perruquier – tirait une corde et l’on basculait dans la baille aux applaudissements de tout l’équipage.
Ce n’est pas tout, une fois dans la toile, quatre pompes d’une force terrible vous crachaient dans la figure à vous asphyxier jusqu’à ce que vous ayez été sorti de l’eau ce qui n’était pas facile.
L’ouverture du théâtre à 7 heures a commencé par quelques chansonnettes et à 11 heures tout était calme, sauf les officiers du bord qui buvaient encore le champagne à 4 heures du matin.
Pour un moment, je croyais être à l’alcazar de Versailles, je ne me figurais pas me trouver à 1000 ou 1200 lieues de la mère Patrie, à l’endroit le plus chaud du globe. La musique se composait de tambours et clairons, d’un harmonium, d’un violon et d’un biniou, espèce d’instrument qui rendait des sons harmonieux, insipides et imitaient fortement le grincement d’une poulie. Tous ces instruments-là marchant ensemble rendaient une harmonie espatrouillante (comme disait Bocquillon).
| Dans "La Lanterne de Boquillon" du 24 février 1878 est publiée cette annonce : |
Voilà mes chers Camarades et Amis sur la mer ce que j’ai à vous dire.
Cependant je dois vous parler du Cap de Bonne Espérance.
Pour traverser ces parages où l’on ne rencontre que des oiseaux, nous avons mis six semaines et nous avons eu 12 ou 15 jours de mauvais temps.
Parmi les oiseaux des parages du Cap, les officiers en ont pris qui avaient jusqu’à 3 mètres d’envergure. On les rencontre jusqu’à vers la hauteur de l’Australie.
Maintenant il me reste à vous parler de la Nouvelle Calédonie. Je ne peux pas vous faire de description bien sérieuse sur ce pays mais cependant je tiens à vous renseigner un peu.
La Nouvelle Calédonie s’étend du Sud/Ouest au Nord/Ouest entre le 20e et le 23e degré de latitude Sud et entre le 161e et le 164e de longitude Est.
Sa longueur est d’environ 170 kilomètres sur 55 de large. A 10 lieues au Sud, se trouve l’île des Pins d’une superficie de 13000 hectares, renfermant une population de 5000 à 6000 habitants, y compris la troupe, les forçats et les Canaques. C’est le dépôt des déportés simples.
Sur la côte Ouest de la Nouvelle Calédonie se trouve une multitude d’ilots parmi lesquels se trouve l’île Noir à l’entrée de Nouméa, plus haut la presqu’île DUCOS (c’est là que Rochefort se trouvait). Les mois les plus frais de l’année sont juillet, août et septembre, et les plus chauds sont novembre, décembre et janvier.
A Nouméa, il y a beaucoup de Canaques, ils ont les parties sexuelles cachées avec une ceinture ou morceau de chiffon. Les femmes au popinée ont une espèce de chemise en forme de peignoir, c’est la tenue de rigueur pour Nouméa. Dans la brousse ils sont vêtus comme nos premiers Pères cependant ils ont quelque chose de caché.
Un gant peut suffire pour en habiller cinq (ils s’enveloppent une partie de la tête). Pour quant aux femmes, elles sont également nues mais elles se cachent les parties sexuelles avec une feuille de banane ou de mam-mam, fruit excellent qui pousse dans la colonie. Elles n’ont rien d’attrayant, ça ne leur fait pas plus d’effet de se montrer nues aux blancs qu’à une femme française du demi-monde de se promener avec son amant sans être gantée. La nudité des noirs scandalise moins l’œil que celle des blancs.
Pour les mœurs du pays je vais vous en dire 2 mots. La Nouvelle Calédonie n’est qu’un pénitencier puisqu’on y envoie toutes les récoltes des Cours d’Assise. On ne rapatrie que ceux qui ont moins de 7 ans à faire. Vous devez comprendre que les autres libérés restant dans l’île, qu’elle ne peut, avec de pareils éléments provenant de l’école du vice avoir des mœurs tirant sur la perversité.
Néanmoins tout est assez tranquille. Sur toute la surface de l’île, il y a beaucoup de Colons, et leur principal commerce consiste dans l’élevage du bétail, il y a des Colons qui ont jusqu’à cinq et même six mille têtes de bétail, sans compter les chevaux. La volaille, quoique chère, on ne la compte pas parce que presque tout le monde en a. Il n’y a pas de Brigade de Gendarmerie qui n’eut trois à quatre cents têtes de volaille. Aussi l’on vit bien. Ici à Nouméa où je vais rester quelques temps, nous avons une pension (sous-Officiers et Brigadiers) qui vaudrait 150 F (??) en ville et qui nous revient de 85 à 90 F (??) par mois, c’est trop cher. On pourrait dépenser un peu moins, car il y beaucoup de gaspillage. En outre de cela on ne connait pas le prix de l’argent. Quand je pense qu’un Brigadier de Gendarmerie touche deux mille cinq ou six cents francs par an sans compter la ration des subsistance qu’on évalue à 35F (??) par mois. Je dis que l’Etat a les reins solides.
Quelques mines d’or commenceraient à être exploitées sur différents points de l’île en même temps que des fabriques pour la canne à sucre s’élèveraient mais depuis l’insurrection des Canaques et la faillite regrettable de la banque, tout est arrêté et je crois que tout cela a porté un fort coup à l’île pour sa prospérité.
Pour l’amusement, c’est un peu monotone, non pas à Nouméa, car on y trouve tout ce que l’on a besoin mais à l’extérieur, dans la brousse, il faut réellement aimer la solitude pour ne pas s’y ennuyer.
A Nouméa les bains sont chers. Pour renouveler les sentiments et nager à son aise dans une eau potable, on vous demande de 5 à 20F (??) et pour ces prix vous ne trouvez que des rivières qui peuvent gravement compromettre votre futur avenir (vous jugerez).
Enfin il faut en passer par là ou perdre l’habitude de cette natation chose difficile surtout dans les pays chauds ou le système nerveux est constamment en révolution (??).
Voilà mes chers copains mes impressions pour le moment. Je pourrai bien encore vous remplir 5 ou 6 pages, mais le temps me manque, le courrier doit partir demain ou après et j’ai encore plusieurs lettres à faire pour d’autre amis.
Dans une autre missive, je vous parlerai des forçats et des évasions qui ont lieu journellement dont les journaux de France ne font jamais mention.
En attendant je termine ma lettre en vous souhaitant à tous les galons de Maréchal de Logis et je fais des vœux pour qu’à mon retour, si Dieu le veut, je vous trouve jouissant d’une santé aussi bonne que celle que j’ai en ce moment.
Votre Collègue et Ami qui vous embrasse et vous serre cordialement la main.
Signé E. BROUVILLE, Brigadier à Nouméa
PS : Bien le bonjour à M. ROUSSEAU, l’employé du Sénat et M. SOUDE, en un mot à ceux que vous jugerez mes amis.











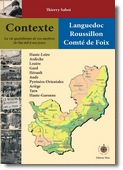


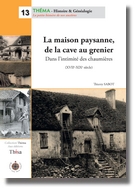


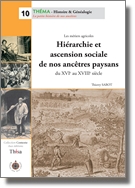


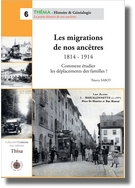
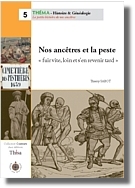


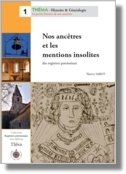


 En 1879, le récit d’un gendarme qui a transporté des forçats en Nouvelle Calédonie
En 1879, le récit d’un gendarme qui a transporté des forçats en Nouvelle Calédonie