Il y a quelques mois, j’ai critiqué l’article Hérédité et Généalogie : jouons aux billes... de Michel Baumgarth, publié dans cette gazette [1]. Celui-ci, par des arguments essentiellement mathématiques, essayait de démontrer qu’il était illusoire de prouver un lien génétique avec d’anciens — voire de très anciens — ancêtres, en utilisant la généalogie génétique autosomale, c’est-à-dire les données issues du séquençage des chromosomes non sexuels (chromosomes 1 à 22). J’ai alors commenté que l’approche de cet article, bien qu’intéressante dans sa vulgarisation, est en réalité trop simpliste, et néglige de nombreux mécanismes biologiques.
Voici aujourd’hui un exemple concret, fondé sur mes propres analyses, qui vient contredire cette position.
Une correspondance islandaise inattendue
D’après mes recherches généalogiques, mes parents ont tous deux une ascendance enracinée dans le Passais ornais et mayennais — une région rurale à l’écart des grands axes migratoires, et surtout éloignée des côtes. Aucune filiation directe avec des ressortissants étrangers, et encore moins nordiques, n’a été détectée dans les actes.
C’est à partir d’un pool (ou cluster) de correspondances ADN atypiques, identifié via un outil de traitement de séquences génétiques sur une plateforme en ligne, qu’un faisceau d’indices en faveur d’une ascendance nordique a commencé à émerger. Cinq individus islandais de ce pool partagent un même segment d’ADN avec ma mère et moi, sur le chromosome 3, entre les positions 56 034 000 et 62 660 000. Ces correspondances sont le plus souvent indiquées avec un "niveau de confiance faible" et une proportion d’ADN partagé inférieure à 0,3 %, ce qui reflète soit un lien génétique très ancien, soit un possible faux positif. Mais un profil ressort : celui d’un individu avec 0,4 % de correspondance, noté "confiance élevée", qui triangule parfaitement avec ma mère et moi sur cette portion.

- Cluster de correspondances ADN issues d’Islande
La puissance de la triangulation
La méthode de triangulation est ici essentielle : elle permet de valider que plusieurs personnes partagent le même segment exact d’ADN, hérité d’un même ancêtre, en comparant leurs données entre elles — et notamment avec celles d’un parent proche. L’alignement des profils islandais sur ce segment précis, combiné à leur isolement génétique connu, rend hautement improbable une coïncidence.
Mais ce n’est pas tout. À partir de ce premier groupe, j’ai identifié quatre autres individus islandais triangulant eux aussi avec ma mère et moi sur cette même région. L’un d’eux partage même un segment de 9 cM, ce qui représente une longueur significative à ce niveau de l’arbre généalogique.

- Capture d’écran montrant une triangulation
Une origine probable médiévale
Compte tenu de l’extrême stabilité génétique de la population islandaise, relativement peu brassée depuis le Moyen Âge, tout converge vers une conclusion : une portion de mon chromosome 3 a vraisemblablement été transmise par une lignée maternelle ancienne, issue d’un ou d’une ancêtre islandaise, probablement d’origine viking.
Cela démontre qu’il est bien possible de détecter des filiations très anciennes par l’ADN autosomal, en particulier lorsqu’elles sont corroborées par des regroupements régionaux solides et des segments triangulés. Ce contre-exemple met en défaut les conclusions trop catégoriques de Michel Baumgarth.
La recombinaison, grande oubliée des modèles simplistes
Un autre point affaiblit encore davantage la thèse de l’article critiqué. Celui-ci comparait les chromosomes à des « billes indivisibles », ignorant la complexité du mécanisme de recombinaison génétique. Or, juste à côté de la portion islandaise sur mon chromosome 3 se trouve une autre correspondance, avec un parent très éloigné identifié généalogiquement (Erwan). Nos ancêtres communs, issus du Passais mayennais, remontent à la fin du XVIIIe siècle. Erwan n’a aucune correspondance ADN avec les Islandais qui triangulent avec ma mère et moi : il ne possède donc pas la portion islandaise du chromosome 3 détectée auparavant. La correspondance avec Erwan, voisine mais ne recouvrant pas le segment islandais, montre qu’une recombinaison a très probablement eu lieu entre deux lignées, démontrant la plasticité des segments héréditaires à travers les générations.
Ainsi, la portion islandaise n’est pas héritée de la lignée d’Erwan, mais d’une autre branche encore muette en correspondances — un « silence génétique » dans lequel pourrait se cacher cette lignée venue du Nord.

- Schéma de recombinaisons chromosomiques

- Mon chromosome 3 maternel
- En jaune, le segment partagé avec Erwan (40.10-55.07 Mb)
En bleu, la portion triangulée avec des Islandais (56.03-62.66 Mb)
La ligne pointillée indique la zone de recombinaison probable
Un haplogroupe évocateur
Enfin, un dernier indice vient renforcer cette piste : l’ADN mitochondrial de ma mère appartient à un haplogroupe également retrouvé chez des squelettes vikings. Ce seul fait ne saurait suffire à une preuve, mais il ajoute un élément supplémentaire à cette enquête, où l’analyse rigoureuse des données ADN dialogue avec l’histoire profonde des peuples.
Conclusion
Ce travail, loin des généralisations statistiques, montre que la généalogie génétique peut bel et bien remonter le fil du temps jusqu’à des origines lointaines — pour peu qu’on sache la lire avec rigueur et patience. Le passé ne se révèle pas dans les moyennes globales, mais dans les fragments ténus d’ADN qui résistent au silence des siècles.













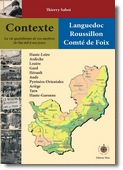


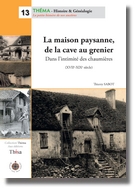


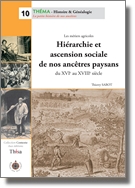


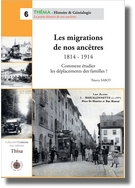
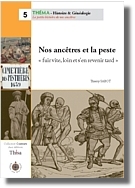


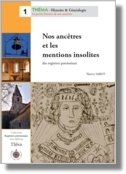


 Une piste viking dans mon ADN
Une piste viking dans mon ADN